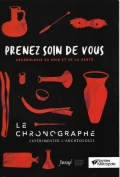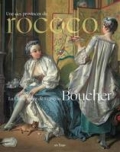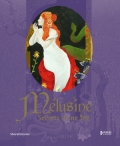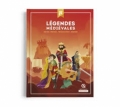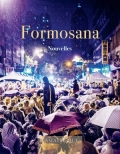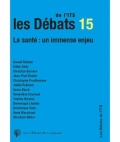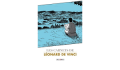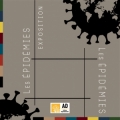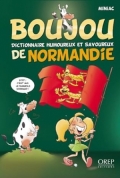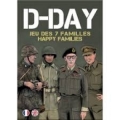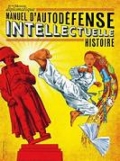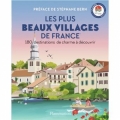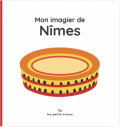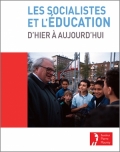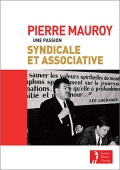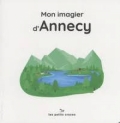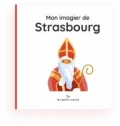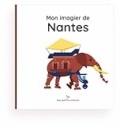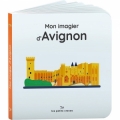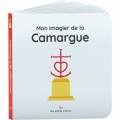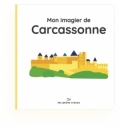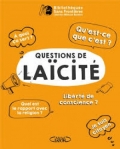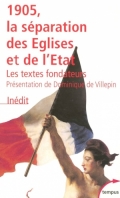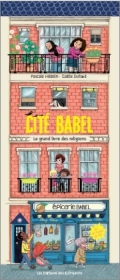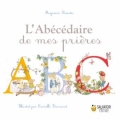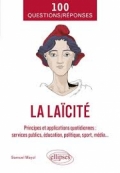Avis de Benjamin : "L’Église catholique se mue et se meut alors dans la laïcité, forme française de la liberté religieuse"
Cet ouvrage rassemble des contributions issues d'un colloque tenu successivement à Rome en 2024 et à Paris en 2025, ces textes retracent l'histoire de l'accord de 1924, entre le pape et la République française. Ceci a donné un statut juridique à l'Eglise catholique en France car elle n’en avait plus depuis le refus de Pie X de lui voir accepter le principe des associations cultuelles.
Après la modification de la loi de 1905, intervenue en 2021, par la Loi confortant le respect des principes de la République (ou Loi contre le séparatisme), via un échange de lettres entre le Vatican (en la personne de Monseigneur Celestino Migliore, Nonce apostolique), et la France (au nom de la Première ministre d’alors Madame Élisabeth Borne), la validité des textes de 1924 sur les associations diocésaines a été confirmée sans besoin d’actualisation de ces derniers.
Il est également question, dans ce livre, le rétablissement des relations diplomatiques entre Paris et Saint-Siège. De plus, à deux reprises, on évoque trop brièvement la loi du 1er juin1924 maintenant le statut concordataire en Alsace-Moselle. Nous ajouterons donc personnellement que cette loi avait une durée d’application de 10 ans. Elle a fait régulièrement l’objet de prorogations, jusqu’à ce qu’une loi du 24 mai 1951 précise que les dispositions du droit local sont toujours maintenues à titre provisoire, mais sans limitation dans le temps. Est citée page 153, sans malheureusement expliciter son contenu, la loi Astier sur l’enseignement professionnel débouchant sur un possible financement public des établissements techniques privés, aussi bien en matière d’investissement que de fonctionnement (ceci concernera, à partir d’une certaine date, les classes technologiques de lycée).
Il y a là des communications provenant d’universitaires comme les Professeurs Philippe Portier de l’École pratique des hautes études (EPHE), Bernard Ardura (du Comité pontifical des sciences historiques) ou Yves Gaudemet de l’Institut de France. Ces dernières ont permis d’approcher les enjeux historiques et juridiques de cet accord de 1924. Par celui-ci l’Église catholique accepte la loi de Séparation et s’intègre (à sa manière) dans la laïcité française.
Des interventions, comme celles du Cardinal Pietro Parolin (secrétaire d’État du Saint Siège) ou celle de Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort (président de la Conférence des évêques de France), prennent une couleur plus militante. Enfin il y a les communications provenant d’autorités françaises qui prennent parfois un petit côté pédagogique de la question des rapports en France entre l’Église catholique et l’État. Relèvent de ce genre en particulier celle de Jean-Noël Barrot alors ministre français des Affaires étrangères (petit-fils au demeurant de Noël Barrot, militant au Sillon de Marc Sangnier et député MRP de Haute-Loire de 1945 à 1966) ou celle de Juliette Part cheffe du Bureau central des cultes au Ministère de l’Intérieur.
Au cours de notre lecture, des informations inédites peuvent surgir. Ainsi apprend-on que l’évêque latin de Bagdad se devait d’être un Français, suite à la donation de 6 000 ducas espagnols faite par Marie Ricouard (née du Gué Reynols, bienfaitrice de Meaux). Le pape Urbain VIII accepte ce don à ces conditions et publie à ce sujet un bref le 4 juin 1638. Le 6 septembre 1632 est la date de création du diocèse de Babylone ou Bagdad, et le premier évêque est espagnol. La tradition de nommer un évêque puis archevêque français ne prend fin qu’en 1972. Par ailleurs on apprend qu’une enquête INSEE de 2023 sur une population de Français entre 18 et 49 ans donne 53% de personnes se disant sans religion. Se déclarent catholiques 25%, musulmans 11%, chrétiens non catholiques 9%, juifs 0,5% et bouddhistes 0,5%.
Au sujet des acteurs de cet accord, jouèrent un rôle important de négociateurs d’un côté le cardinal Pietro Gasparri (d’ailleurs il signa, en 1929 avec Mussolini, les accords du Latran réduisent la souveraineté temporelle du pape au seul État du Vatican) et Mgr Bonaventura Cerretti nonce apostolique à Paris de 1921 à 1926 mais aussi Mgr Chapon évêque de Nice et l’abbé Ferdinand Renaud aumônier au collège parisien Stanislas. Le pape est alors Pie XI.
De l’autre côté se trouve Charles Jonnart (député puis sénateur Alliance démocratique du Pas-de-Calais, un temps gouverneur d’Algérie) alors ambassadeur français au Vatican ainsi que Louis Cant conseiller du ministre des Affaires étrangères et Léon Noël chef adjoint du ministre de l’Intérieur. Raymond Poincaré, président de la République de 1913 à 1920, fut président du Conseil de janvier 1922 au 1er juin 1924, ce qui explique son rôle d’impulsion; notons qu’Aristide Briand, ministre des Affaires étrangères et simultanément président du Conseil, durant toute l’année 1921 joua un rôle en amont pour faciliter la normalisation des relations entre la France et le Saint-Siège.
Pour connaisseurs Aucune illustration

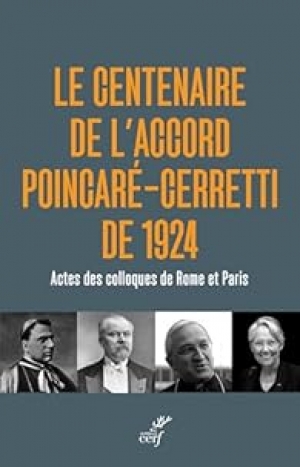


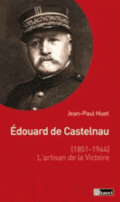
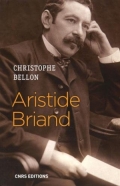

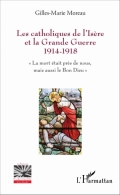
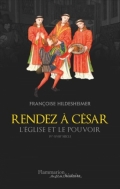
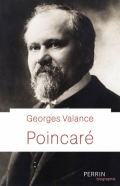
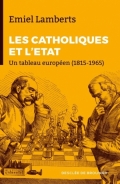

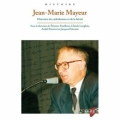


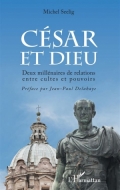
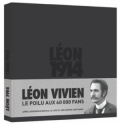
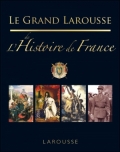
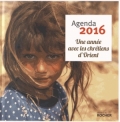
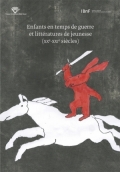
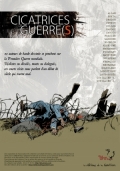
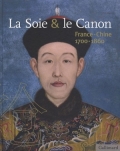
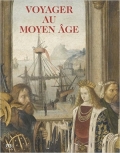
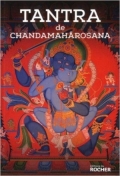
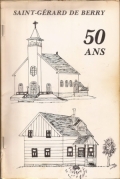
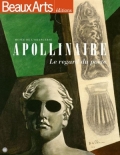
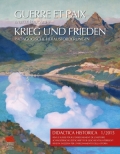




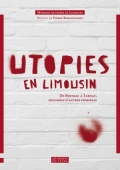
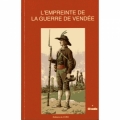
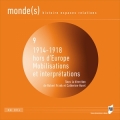
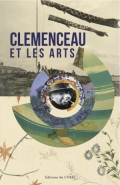
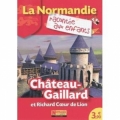
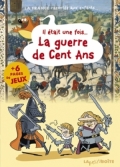
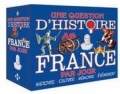

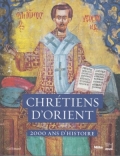
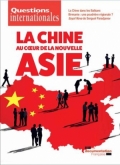
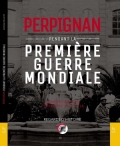
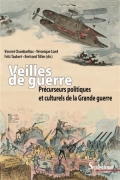


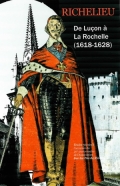



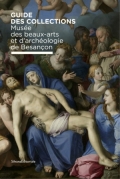
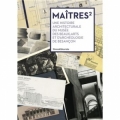
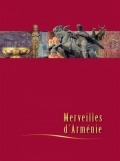

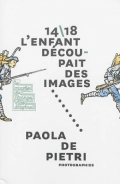

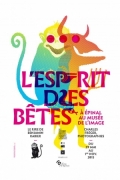

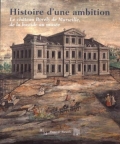

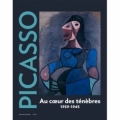
![Hors cadre[s], n°25 Hors cadre[s], n°25](/img/livre/collectif-hors-cadre-s-n-25_thumb.jpg)