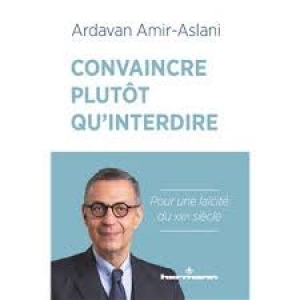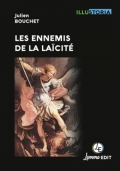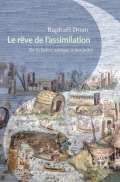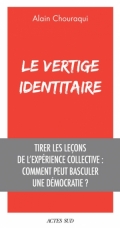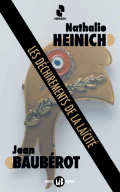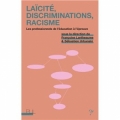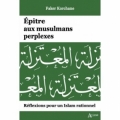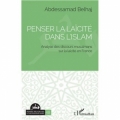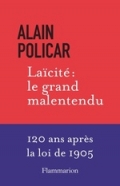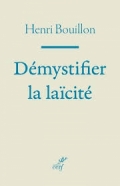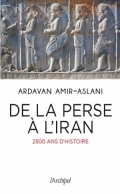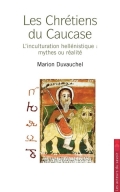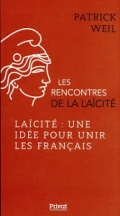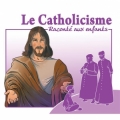Avis de Adam Craponne : "À l’assaut de certaines vérités alternatives sur la laïcité"
Dans son introduction, l’auteur explique qu’il commencera « par déconstruire certaines perceptions simplistes de l’islam en France, (afin) de contribuer à une meilleure compréhension des musulmans dans notre pays ». Dans sa seconde parte, Amir-Aslani entend relater les échecs successifs de constituer en France une instance représentative et durable des musulmans de France afin d’engager un dialogue constructif avec l’État. Pour sa dernière partie, Ardavan Amir-Aslani désire « proposer ce que pourrait être une vision rénovée de la laïcité, adaptée aux réalités de notre époque ».
Nous avons relevé plusieurs idées fortes dans ce livre Convaincre plutôt qu’interdire: Pour une laïcité du XXIe siècle. Nous citerons celles-ci :
« Les fractures sont nombreuses : territoriales, économiques, sociales, politiques et culturelles. Pourtant, la France dispose d’un outil fondamental, ancré dans sa tradition républicaine : la laïcité. Celle-ci, souvent incomprise à l’étranger et fréquemment critiquée par les pays anglo-saxons, qui la perçoivent comme un obstacle à l’intégration des minorités religieuses, est aujourd’hui considérée en France comme une force distinctive. Elle permet de préserver la neutralité de l’État, de garantir la liberté de conscience et du culte de chacun, tout en maintenant une distance avec les influences religieuses au sein de l’espace public. La laïcité est le socle de notre "vivre-ensemble" dans une société diversifiée, où la religion, bien que respectée, ne doit pas dicter nos orientations publiques, sociales ou privées ». (page 9)
« Autrefois pensée pour une France majoritairement catholique, elle doit aujourd’hui s’adapter à un paysage religieux profondément transformé, dans lequel l’islam occupe une place grandissante. Le débat actuel autour de la laïcité ne se réduit donc pas à une simple application de lois établies ; il engage une réflexion plus profonde sur les valeurs mêmes de la République, sur l’intégration des minorités, sur la diversité culturelle et sur l’identité nationale ». (page 10)
« Certains prônent une laïcité plus moderne et inclusive, considérant que l’application trop stricte de la laïcité actuelle risque de renforcer l’exclusion de certaines communautés, en particulier les musulmans. Pour ces voix critiques, la laïcité, pensée comme un outil d’intégration, s’est transformée en un instrument de contrôle, sinon de répression, envers certaines minorités. Cette rigidité pourrait, selon eux, nuire au "vivre-ensemble" en accentuant les sentiments d’exclusion et de marginalisation parmi les populations visées ». (page 11)
« La laïcité identitaire pour sa part, distingue les religions qui appartiendraient à l’identité de la France et celles dites "rapportées". Aujourd’hui, certains groupes, principalement à l’extrême-droite, mais seulement, ne font pas mystère de leur volonté de lutter contre l’islam. Ils entendent bien instrumentaliser la laïcité, compte de l’importance que lui accordent les Français, à cette fin ». (pages 73-74)
« À la traîne de l’extrême-droite, une partie de la droite, au début des années 2000, a lancé dans le débat public une nouvelle conceptualisation de la laïcité, fondée sur l’identité religieuse de la France, se dressant au demeurant des constats justes sur "les ratés de l’intégration", la nécessité de "viser seulement l’islam fondamentaliste tout en aidant les nombreux musulmans qui souhaitent pratiquer leur culte dans la paix et la dignité", avec l’objectif de "créer de vraies élites républicaines issues de l’immigration" ». (les expressions citées par l’auteur ont été employées par François Baroin dans son rapport Pour une nouvelle laïcité remis en 2003) (page 75).
« On doit enfin à Nicolas Sarkozy d’avoir, le premier, fait de la laïcité d’émancipation et de tolérance un marqueur culturel, ce qu’elle n’a jamais été, et de permettre, du moins dans ses discours, une limitation de la liberté de conscience afin de préserver l’identité culturelle française, etc., définie selon des caractéristiques choisies et sans équivoque : catholique. Pour les polémistes d’extrême-droite qui défendent une laïcité identitaire et en ont aujourd’hui récupéré les principes, l’obligation de neutralité est inversés » (page 77).
« La création d’une instance représentative est nécessaire. Jusqu’à présent, en effet, celle qui en a eu cette charge – le CFCM – et les associations diverses qui se sont constituées se donnaient pour mission de représenter les croyants musulmans, mais sans avoir été choisies pour cela par ces mêmes croyants, et surtout sans opérer l’indispensable travail d’ijtihad, d’interprétation des textes sacrés à l’aune du monde contemporain, qui manque pourtant cruellement à l’islam pour s’intégrer facilement dans la société française. En effet, tout le travail d’obtention d’un "islam réformé" reste à entreprendre » (page 96).
« La laïcité du XXIe siècle doit être pensée comme l’aboutissement d’un processus intellectuel et historique profondément ancré dans l’expérience républicaine de la France. Face aux discours simplistes et anxiogènes qui alimentent l’imaginaire de certains courants extrémistes, il devient urgent de recentrer la laïcité sur ses fondements philosophiques : elle n’est ni un instrument de coercition ni une stratégie de gestion des religions, mais un cadre de liberté et de coexistence destiné à accueillir toutes les formes de conscience et de croyance de l’espace public républicain ». (page 120)
« Dans ces espaces où l’État peine à assurer sa présence, une "réactivation des appartenances" émerge comme un baume pour les blessures sociales. L’islam, ici, devient alors le symbole de résistance au déclin économique et au déracinement. Il nous appartient de faire une priorité de ce que ces territoires marginalisés ne présagent pas un avenir de "communautarisation généralisée" » (page 124).
Pour tous publics Aucune illustration