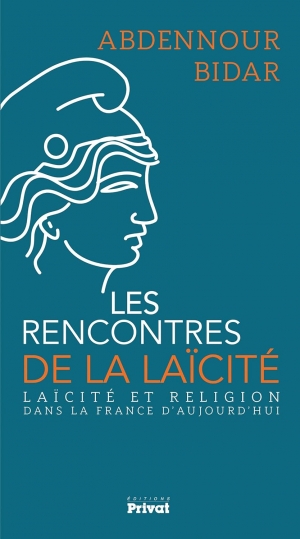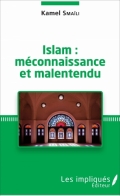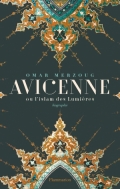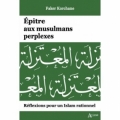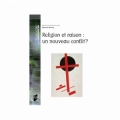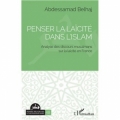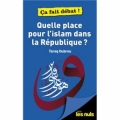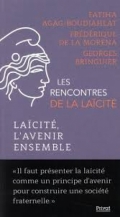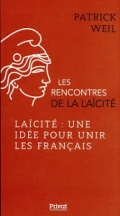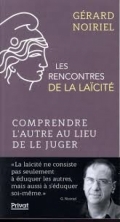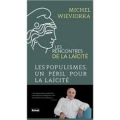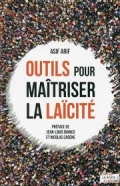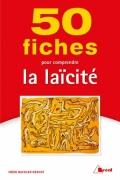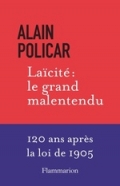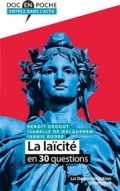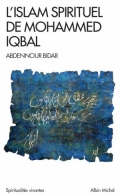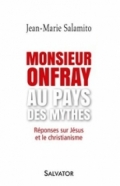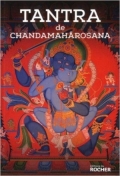Avis de Benjamin : "Le mot du Festival du mot de La Charité fut laïcité en 2015"
On se reportera à "Festival du Mot - Alain Rey : Le mot de l'année" https://www.youtube.com/watch?v=y8jC4s4sz4c. Notons que cette même année 2015, les internautes belges avait choisi "spoiler" comme nouveau mot de l’année, signifiant "gâcher l’effet de surprise en dévoilant l’intrigue d’une œuvre, le résumé d’un film, le résultat d’un jeu".
Abdennour Bidar est un agrégé de philosophe et un écrivain. Il est nommé inspecteur général de philosophie par l'Éducation nationale le 17 mars 2016. Il abandonne alors la présentation de "l'émission Cultures d'islam" sur France Culture, dont il avait assuré l’animation pendant un peu plus d’un an. Abdennour Bidar est alors membre de l’Observatoire de la laïcité.
Georges Méric, président du Conseil départemental de Haute-Garonne de 2005 à 2022, donne une préface de huit pages. Il déclare : « La laïcité, pour nous associe la foi à un état d’esprit de vie, un principe d’organisation du vivre ensemble. C’est d'abord un état d’esprit fondé sur la capacité des hommes à penser par eux-mêmes et de s’émanciper par l’accès à la connaissance. C’est aussi une propension à penser par soi-même fondée sur la raison, véritable sésame vers une liberté ouverte à tous les possibles, dans une approche multiple, hors des carcans et des geôles de l’esprit, où l’être humain dégage sa pensée du dogmatisme, de la soumission à une quelconque autorité ou vérifié définitive, voire révélée » (page 10 à 11). Ces Rencontres de la Laïcité se terminent, comme habituellement, par une série de questions venues de l’auditoire.
Auparavant Abdennour Bidar a fait un long exposé. Il entend repousser tant une laïcité qui veut exclure toute manifestation de l’espace public qu’une laïcité qui verrait dans la laïcité une neutralité se traduisant par une absence de valeurs à défendre pour l’État et cela autoriserait des manifestations religieuses contraires à la devise de la République française et aux droits de l’Homme. Il ne faut pas concevoir une neutralité de l’État mais une impartialité de celui-ci.
Après avoir recherché les origines et l’originalité de la laïcité française, Abdennour Bidar parle ensuite de la vision de laïcité dans d’autres pays puis de la vision conflictuelle de la laïcité qu’ont certains musulman. Chemin faisant, il a pu ainsi s’interroger sur la liberté d'expression religieuse dans un cadre laïque, la possibilité d’appui sur la laïcité pour l’éducation à la citoyenneté, la construction d’une fraternité républicaine et d’une spiritualité transcendant les cultures et les croyances (y compris celle des libres-penseurs).
On trouve quelques formules chocs :
« La laïcité a justement été institutionnalisée dans le but de garantir l’égalité de droit, de conviction – quelle qu’elle soit–, et d’expression dans nos espaces sociaux. L’on peut mesurer, encore une fois, les ravages causés par ce qu’il faudrait appeler l’intoxication, la désinformation résultant du travail de lobbies de toutes sortes, insinuant progressivement dans les esprits l’idée qu’il y aurait un choix à faire : être laïc ou être croyant, être laïc ou être musulman » (page 24).
« Dans le domaine religieux comme dans n’importe quel autre domaine idéologique, on trouve des subjectivités aliénées et endoctrinées qui se croient libres alors qu’elles ne le sont pas » (pages 40-41).
« Non, nous n’acceptons pas que les femmes et les hommes vivent séparés. La mixité entre femmes et hommes est notre modèle de société, de sociabilité, de civilisation, et nous y tenons. Instituer cette séparation reviendrait à dire que toute relation de travail, de confiance, de proximité humaine, affective ou intellectuelle entre un homme et une femme est impossible. Ce serait insinuer – et c’est bien là le sens anthropologique implicite de cette séparation – que les hommes sont des êtres lubriques et les femmes des séductrices » (pages 46-47).
« Voici un exemple de contradiction : le "droit à la différence". Comme certains le rappellent , il ne signifie pas "différence des droits". Si notre société commence à donner des droits différents en fonction des communautés culturelles, on risque un excès dans la reconnaissance du droit à la différence. C’est le cas lorsqu’on décide, par exemple, d’accorder tel jour la jouissance de la piscine municipale à des femmes qui, par conviction religieuse, refusent d’être en présence des hommes » (pages 56-57).
« Revenons maintenant à la question la plus urgente pour notre société. Comment faire en sorte qu’à l’intérieur d’un cadre laïque, sous cette clé de voute qu’est la laïcité, nous vision ensemble une liberté, une égalité et surtout une fraternité qui auraient l’immense valeur d’être à la fois des vertus éthiques, sociales et spirituelles » (page 88).
Abdessamad Belhadj dans Penser la laïcité dans l’islam, avançait que Abdennour Bidar promouvait une synthèse entre l’islam spirituel et les Lumières françaises. Sa conception de la spiritualité laïque est largement recevable par une bonne part des non-musulmans mais ne risque-t-elle pas d’avoir un écho très marginal au sein des fidèles de Mahomet. La sociologie américaine nomme "native informant", des porte-paroles médiatiques d’une communauté auprès de laquelle leurs discours reçoivent peu de soutiens, mais qui séduit une large part de la société dans laquelle ils vivent. Dans quelle mesure la parole d’Abdennour Bidar est-elle audible par ses coreligionnaires ?
Pour tous publics Aucune illustration