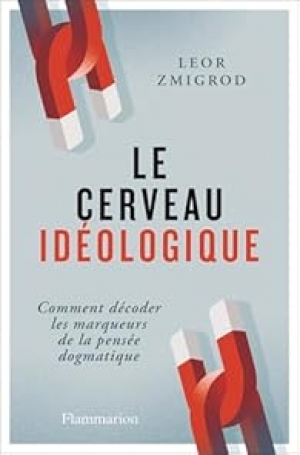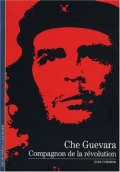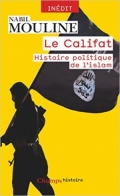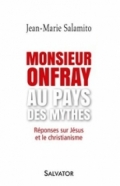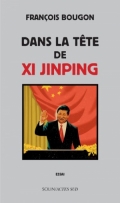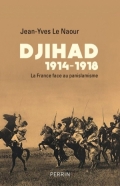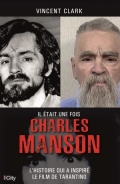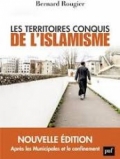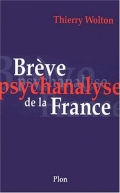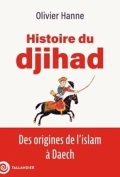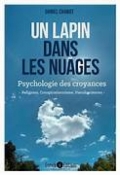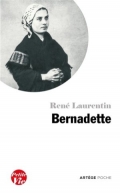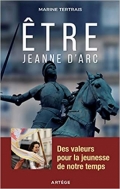Avis de Patricia : "Un cerveau idéologique est un cerveau profondément endoctriné par une idéologie rigide"
Un foisonnement de groupes idéologiques propose, en ce XXIe siècle, des réponses absolues et utopiques aux problèmes sociétaux, des règles de comportement strictes et une mentalité d'endogroupe à travers des pratiques et des symboles codifiés. On peut penser aux idéologies de démocratie illibérale (tendant vers une sorte de fascisme), à l'éco-activisme, au catholicisme traditionnalste, au radicalisme islamique teinté de salafisme, à certains mouvements évangélistes et aux Témoins de Jéhovah.
Le livre Le Cerveau idéologique a pour sous-titre Comment décoder les marqueurs de la pensée dogmatique. Il est paru en Grande-Bretagne en 2025, sous le titre de The Ideological Brain. Il est composé de quatre parties, à savoir "Icônes", "Du mythe et de l’esprit", "Les origines", "Les conséquences", "Liberté". Chaque partie compte trois à cinq chapitres. Dans le premier volet , l’auteure avance des arguments qui l’amène à poser l’hypothèse que « la rigidité cognitive se traduit par une rigidité idéologique » (page 38). Elle évoque notamment le test Wisconsin Card Sorting, les expériences d’électrocution de Milgram, l’expérience de la prison de Zimbardo et la métaphore de l’esprit vide avancée par Hannah Arendt. Pour Leonor Zmigrod « chacune de nos pensées est physique ; chacun de nos rêves, chacune de nos convictions est une signature biologique produite par le corps et par le cerveau » (page 52).
Au début du quatrième chapitre, elle présente Antoine-Louis-Claude Destutt de Tracy né le 20 juillet 1754 à Paris, où il meurt le 9 mars 1836. Il a suivi l’école d’artillerie de Strasbourg, est entré chez les mousquetaires de la maison du roi puis a été notamment colonel d’un régiment de cavalerie. En 1776, il est devenu franc-maçon, dans la loge La Candeur du Grand Orient de France. Il fut député aux États-Généraux et choisit de siéger à la Constituante. Il baptise l’étude des idées de l’esprit humain sous le nom d’"idéologie" et invente ce mot alors que, sous la Terreur, il est incarcéré à la prison parisienne des Carmes. Vers 1795, avec un groupe de penseurs, il fonde la société des idéologues. Il commence à publier en 1801 Élemens d'idéologie (sic), l’ouvrage aura plusieurs tomes ; l’idéal politique visé est la promotion des réformes laïques et antiautoritaires effectuées sur des bases rationnelles et scientifiques. « Au lieu de se reposer sur les conventions ou leur héritage, élèves et étudiants placeraient leur foi dans la raison, dans l’observation et dans une connaissance solide de l’épistémologie. Les futurs citoyens se libéreraient des us et mœurs traditionnelles et des doctrines paralysantes. L’éducation serait un instrument d’émancipation politique » (page 68).
Élu membre et secrétaire du comité de l’instruction publique, il a participé à la réorganisation de l’enseignement national en France et publié, à cette occasion, des Observations sur le système actuel d'instruction publique, en 1800. Son ami l’abbé Sieyès, devenu brièvement consul puis président du Sénat conservateur, l’a fait nommer sénateur inamovible sous le Consulat. Membre de la société d’Auteuil, il montre son opposition philosophique au pouvoir de Napoléon.
Ce dernier, dès le Consulat, tonnait contre Antoine-Louis-Claude Destutt de Tracy et ses disciples. Napoléon déclarait ainsi en 1802 : « Mon aversion va jusqu’à l’horreur pour cette race d’idéologues » (page 72). Dans sa boucle le mot "idéologiste" devient "idéologue" et il en fait une injure qualifiant un idéaliste travaillant dans les idées abstraites et n’ayant aucun sens pratiques, bref des rêveurs dangereux arrogants. Talleyrand rapporte ces propos de l’Empereur : « Messieurs les philosophes se tourmentent à créer des systèmes ; ils en cherchent en vain un meilleur que le christianisme qui, en réconciliant l’homme avec lui-même, assure en même temps l’ordre public et le repos des États. Vos idéologues détruisent toutes les illusions ; et l’âge des illusions est pour les peuples comme pour les individus l’âge du bonheur » (page 73).
Marx invente lui le mot "idéologie" et porte un regard critique sur son contenu. Pour lui et pour Engels « l’idéologie est faite pour donner aux inégalités l’apparence de la naturalité, de l’immuabilité et de la vertu ; que les rapports de force sont naturalisés, comme la vie sociale avait toujours été ainsi et le serait toujours » (page 77).
Selon notre auteure « l’idéologie est l’exquise réponse du cerveau au problème de la prédiction et de la communication. Elle apporte des solutions simples à nos questions, des scénarios faciles à suivre, des groupes auxquels appartenir. Guidant nos pensées et nos actions, l’idéologie est le raccourci qui conduit à notre désir de comprendre le monde et d’en être compris en retour » (page 99).
Au chapitre suivant, le septième intitulé "Penser idéologiquement", Leonor Zmigrod affirme que « la pensée idéologique est fidèle à son nom : elle est super- et même hyper-logique, et c’est pourquoi elle est si tentante et dangereuse » (page 101). À ce propos Hannah Arendt écrit « la pensée idéologique ordonne les faits en une procédure absolument logique qui part d’une prémisse acceptée pour axiome et en déduit tout le reste » (page 101). Leonor Zmigrod poursuit : « Penser idéologiquement, c’est juger la morale immuable et le changement suspect. C’est partir du principe que les gens ne changent jamais vraiment, et que seuls les imbéciles refusent ou dénient ce qui est prédéterminé » (page 103).
Leonor Zmigrod distingue les idéologies régressives des idéologies progressistes. Les premières veulent restaurer les anciennes hiérarchies de pouvoir au nom de caractéristiques de lieu, de race, de genre, de classe ou de caste. Les secondes marquent une réprobation envers ceux qui contestent l’utopie progressiste, fréquentent les mauvaises gens ou consomment les mauvais produits. Ces deux idéologies ramèneraient à la binarité du bien et du mal mais aussi du vrai et du faux, bref tendent vers le manichéisme.
Notre auteur démarre sa troisième partie en présentant une enquête en 1944, menée auprès d’enfants par Else Frankel-Brunswick dont l’objectif était de voir quand et comment un enfant ethnocentrique peut devenir un fasciste donc un être sensible à la xénophobie et à l’autoritarisme. Les conclusions ont donné lieu à publication en 1950 dans The Authoritarian Personality. Dans ce dernier ouvrage, Adorno définit par neuf traits la personnalité autoritaire. Ces caractéristiques sont : le conventionnalisme, la soumission autoritaire, l'agressivité autoritaire, l'anti-intraception, la superstition et les stérotypes, le pouvoir et la dureté, la destructivité et le cynisme, la projectivité et les préoccupations sexuelles exagérées.
Avec le onzième chapitre, Leonor Zmigrod termine par ceci : « Les études expérimentales que j’ai supervisées ont fait apparaître encore une fois que la rigidité cognitive d’un individu était corrélée à son acceptation de la violence idéologique contre un exagroupe. Plus il est inflexible, plus il est prêt à faire mal à autrui au nom de son groupe. Nos tendances cognitives sont liées à nos indications idéologiques. Les origines de nos convictions les plus profondes remontent à notre style cognitif et à notre personnalité, mais l’un et l’autre ont aussi leur histoire. Que l’on soit fier un non de ses ancêtres, le corps que nous habitons et notre généalogie forment une seule et même trame. Une histoire est cachée dans notre biologies et cette histoire canalise nos engagements présents et nos possibilités futures » (page 187).
Dans le chapitre suivant est évoquée la dopamine, une molécule biochimique permettant la communication au sein du système nerveux. Elle influencerait directement le comportement. Leonor Zmigrod écrit : « j’ai observé que les individus qui montraient la rigidité cognitive la plis grave avaient une prédisposition génétique à concentrer une moindre quantité dans le cortex préfontal, le centre de prise de décision du cerveau, et une plus grande dans le stratium, une structure nerveuse située dans le cerveau moyen, qui contrôle nos instincts rapides. Cela est significatif. Si notre rigidité psychologique repose sur une vulnérabilité biologique, par exemple sur la façon dont le cerveau produit de la dopamine, alors il devient possible de trouver un chemin entre le biologie et l’idéologie » (page 191). Elle conclut ce douzième chapitre sur un mode de prudence. Il faut « nous éloigner de l’idée que le dogmatisme est soit le produit de notre vulnérabilité biologique, soit l’effet d’un endoctrinement » (page 205).
Le quatrième volet débute en rappelant certains aspects méconnus de la pensée de Darwin. « Darwin pensait que les conséquences de l’inculcation religieuse et la répétition de la pratique religieuse pouvaient être profondes et durables, et biologiquement tout aussi réelles que les instincts animaux et le patrimoine génétique » (page 214). Elle affirme que « plus les gens pratiquent une religion, plus ils se livrent à des rites répétitifs, prient et participent à des cultes, plus leurs résultats aux tests neuro-psychologiques traduisent une forte rigidité » (page 219). Elle termine ce chapitre par ceci : « la religion est un cadre perceptuel, un cadre d’esprit qui altère l’intensité aussi bien de ce que nous sentons que de ce que nous ne remarquons pas. Les significations surnaturelles reposent sur des expériences sensorielles. Doutes et dissonances sont réduits au silence » (page 224).
Le quatorzième chapitre commence par évoquer le dessin, paru dans un magazine humoristique allemand en 1892, donnant l’illusion soit d’un canard soit d’un lapin, dont d’ailleurs l’auteur est inconnu. Elle continue en citant l’effet Simon qui correspond à notre capacité à répondre à un stimulus. Elle clôt ce chapitre en citant Susan Sontag qui, pour écarter des interprétations biaisées déclarait : « Nous devons apprendre à voir plus, à entendre plus, à sentir plus » (page 245). Bref il s’agit de se dégager des idéologies pour aller vers des sensations directes.
Dans les deux derniers chapitres de cette quatrième partie, il est question spécialement de la façon dont des individus imprégnés d’une idéologie peuvent réagir face à des contenus de vidéos qui pourraient remettre en cause leurs croyances ou au contraire les conforter. On relève également ceci : « Les chercheurs de Barcelone étudièrent la signature neuronale des valeurs sacrées de citoyens espagnols d’extrême-droite et d’immigrés djihadistes. Ils observèrent que deux sous-régions du cortex préfrontal ventromédian et le gyrus frontal inférieur – étaient impliquées dans le traitement des valeurs sacrées, mais pas dans celui des valeurs non sacrées. S’agissant des djihadistes, par ailleurs, plus le sentiment de fusion identitaire avec l’islam et l’oumma était fort, moins le cortex préfrontal était mobilisé. Nos engagements les plus profonds ne modulent que les processus neuraux qui ont lieu dans le cortex préfrontal » (pages 278-279).
Le dernier volet du Cerveau idéologique démarre ainsi : « l’idéologie est une histoire d’inévitabilité. Interdits, commandements, lois logiques, dangers dystopiques et rêves utopiques : tout est mis au service d’un récit causal, d’où transpire un climat de pesante nécessité. De ces récits de prédestination, religieux ou romantiques, nationalistes ou pseudo-scientifiques, il se dégage l’idée que quelque chose doit arriver, qu’il ne peut en aller autrement » (page 283).
Quelques pages plus loin, notre auteure écrit : « Pour représenter le déplacement sur le spectre de la pensée idéologique, la spirale présente plus d’un avantage. Elle peut avoir besoin au début d’apports conséquents sur sa surface externe (de grands actes de foi), pour former une boucle de plus en plus serrée qui s’enroule de plus en plus rapidement sur elle-même. Nous retrouvons ici l’accélération du processus d’adhésion : une fois franchi le seuil de l’admission, les demandes cultuelles de sacrifice se font de plus en plus dures et sévères. Le converti veut à tout prix se lancer dans des actes qu’il jugeait avant cela détestables. À mesure que l’idéologie rend le cerveau de l’adepte de plus en plus dogmatique, il se produit un effet d’autorenforcement : chaque déplacement vers l’extrémisme devient plus facile, chaque enfoncement dans les profondeurs plus aisé » (pages 285-286). Leor Zmigrod avance ensuite que : « l’idéologie rigide attirera et satisfera l’esprit rigide, émotionnellement volatil, bien plus que l’esprit flexible émotionnellement stable » (page 286). Elle conclut ce chapitre en soulignant qu’un environnement stressant altère les processus cognitifs et impacte la pensée idéologique.
D’ailleurs elle démarre le chapitre suivant en déclarant que le stress rigidifie la pensée, rend moins adaptable, plus belliqueux et plus enfermé dans les habitudes. Elle pointe comme menaces pouvant engendrer du stress : l’exclusion sociale, les situations de pénurie, l’angoisse existentielle, l’enfermement dans un univers numérique, l’âge de l’adolescence (période de vulnérabilité). Pour Leor Zmigrod il n’y aura jamais d’idéologie de la liberté par contre il y a une philosophie de la liberté. En conséquence « la nouvelle science du cerveau idéologique doit insuffler de la vie aux philosophies qui se prétendent malléables et antidogmatiques » (page 324).
Les chapitres de cette dernière partie sont suivis d’un épilogue où notre auteure rapporte qu’une étude de l’idéologie du point de vue de sa moralité ou de son immoralité se faisait jusqu’alors sous les angles suivants : analyses historiques des souffrances passées, définitions philosophiques ou théologiques de catégories morales abstraites universelles, comparaisons culturelles entre les idéologies existantes, rapports économiques et sociaux, témoignages individuels de gens victimes d’idéologies dominantes injustes.
L’intérêt de l’ouvrage Le cerveau idéologique est d’avoir exposé une nouvelle focale, en s'appuyant sur les neurosciences, à savoir qu’il existe des paramètres biologiques permettant d’approcher le fait que des individus auront une propension plus forte d’aller vers des idéologies les enferment dans une rigidité mentale. Il faut modérer ces propos sur la vulnérabilité face à l’idéologie, car si les explications biologiques autour de la rigidité mentale semblent faire foi, ce n’est pas pour autant que les individus ne sont pas prêts à faire évoluer certaines de leurs valeurs. Encore faut-il que les circonstances s’y prêtent un peu !
Notre auteur conclut son livre Le cerveau idéologique par ceci : « Je pense nous devons développer des modes de vie et de penser – seuls et ensemble– qui ne soient pas idéologiques. Des manières d’exister qui résistent partout aux doctrines et aux identités rigides. Des qui rejettent activement les tentations du dogme, et de façon inventive. Je crois que, pour s’opposer à la rigidité mentale, il faut envisager ce à quoi pourrait ressembler un cerveau anti-idéologique. Un esprit libre et libéré de tout dogme et de toute idéologie » (page 335). On apprécie l’index de dix pages portant tant sur le nom d’auteurs, que sur le titre d’ouvrages, l’intitulé de concepts, le thème des sujets d’étude (comme les bébés ou les mormons), le nom de tests.
coup de coeur !Pour connaisseurs Aucune illustration