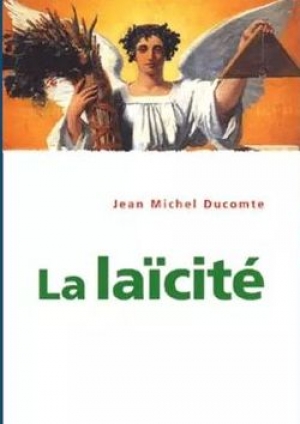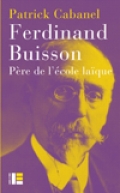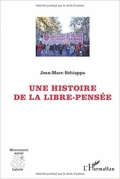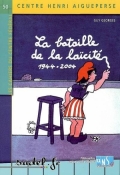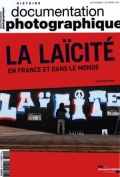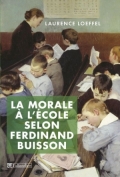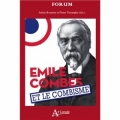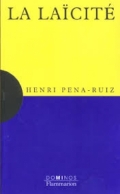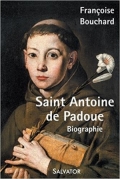Avis de Benjamin : "Un instrument de paix civile et religieuse"
L’ouvrage est composé de six parties. Elles se nomment respectivement : L’invention de la laïcité, Le modèle laïque français, La laïcité au-delà des frontières, Une société devenue complexe, La permanence des interrogations, Approfondir.
Dans le premier point du premier chapitre, l’auteur entend révéler que la laïcité puise son origine dans la volonté multi séculaire de dégager l’être humain du principe d’autorité. Socrate et Aristote sont évoqués mais également Avicenne et Averroès. Progrès des sciences et des techniques, sans compter l’esprit des Lumières amènent une vague qui recouvre la chape de plomb que le christianisme avait progressivement imposé à partir du moment où il était devenu religion officielle. Par ailleurs des légistes et en particulier ceux de Philippe le Bel entendent affirmer l’autorité de l’État sur tout ce qui relève du temporel.
La laïcité a ses martyrs elle aussi, ceux sont notamment les victimes de l’Inquisition et le chevalier de La Barre. La statue de ce dernier est présentée et on note que l’initiative de sa fonte sous l4occupation est à juste titre attribuée au gouvernement de Vichy et non aux Allemands, erreur très courante s’expliquant par le fait que le IIIe Reich confisque sans ménagement les métaux récoltés pour fondre des canons à destination du front. Jean-Michel Ducomte s’attache ensuite à montrer combien la Révolution renversa les perspectives. Le contenu du Concordat est ensuite présenté, il instaure à la fois la cohabitation de quatre cultes (catholicisme, calviniste, luthérien et juif) mais aussi la salarisation de ses ministres et la surveillance de ces religions (en plusieurs occasions les religieux sont privés ponctuellement de traitement pour actions ou paroles intempestives).
La loi du 12 juillet 1875 porte sur l’enseignement supérieur, on se félicite qu’elle soit ici citée même si elle n’est pas explicitée. C’est la dernière offensive avant 1914 de l’enseignement catholique et elle vient en prolongement de la loi Falloux datée de 1850. Face au refus du régime républicain que la presque totalité du clergé catholique, la laïcité se fait anticléricale. Le dernier point de ce premier chapitre traite du lexique.
Dans la seconde partie, on démarre en citant des grandes figures de la laïcité, sont ainsi présentés Condorcet, Auguste Comte, Émile Littré, Charles Renouvier, Paul Bert, Ferdinand Buisson et Émile Combes. Jules Ferry se voit consacrer deux pleines pages. D’autres sujets ont droit à la même surface : la loi de 1905, les exceptions territoriales où la loi ne s’applique pas (ce qui est dit pour Mayotte n’est plus valable depuis sa départementalisation). Ce chapitre sa clôt en évoquant les organisations laïques : franc-maçonnerie, Ligue de l’enseignement, Ligue des droits de l’homme, le Comité d’action laïque en rappelant qu’il est l’émanation concentrée du Cartel d’action laïque. Sont simplement cités la Libre Pensée, l’Union rationaliste et le Centre d’action européenne démocratique et laïque (publiant la revue Europe et laïcité) qui nous semble en état de fossilisation.
Le troisième chapitre disserte notamment autour de la conception de la laïcité en Turquie, Mexique, Japon et Inde d’un côté et divers pays européens de l’autre. La partie suivante s’interroge sur le réveil identitaire, l’évolution du paysage religieux et le phénomène sectaire.
L’avant-dernière partie rappelle que la liberté religieuse n’est pas synonyme de laïcité. Individuellement nous évoquerons les cas de l’époque suivant l’édit de Nantes où seuls le catholicisme et le calvinisme avaient droit de cité (et encore avec des restrictions pour le second, totalement interdit par exemple à Paris), du Concordat (quatre cultes autorisés) et de l’Indonésie où le mariage civil est interdit et chaque citoyen se doit de déclarer sa religion dans les documents administratifs. On ne peut se dire sans religion, certaines religions ne sont pas reconnues et le blasphème est sanctionné. Des questions diverses apparaissent là, comme les conséquences du libéralisme économique, de l’usage de nouveaux médias et de la contestation de données scientifiques. On se doit de s’appuyer sur l’idéal démocratique, la philosophie des droits de l’homme, l’exercice de la lucidité, du doute et de la curiosité fraternelle.
Enfin la dernière division propose un glossaire (noms communs et noms propres confondus), un index (noms communs et noms propres confondus), une chronologie de la laïcité française courant de 1789 à 1999 ou 2004 (selon les éditions), une bibliographie sélective.
Pour tous publics Beaucoup d'illustrations