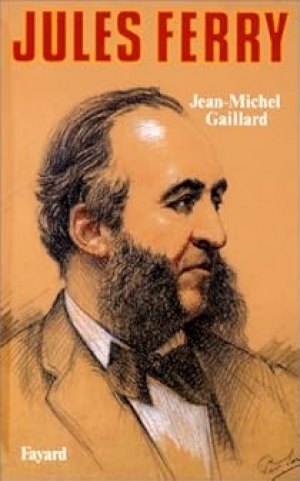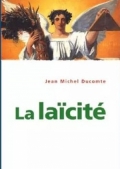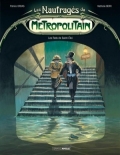Avis de Benjamin : "S’il a fait la France, c’est dans un style que les Français ont le plus grand mal à reconnaître et à épouser (Mona Ozouf)"
La première partie de cet ouvrage couvre une centaine de pages, elle est consacrée à l’enfance et la famille du personnage. On apprend là en particulier qu’Abel Ferry, futur député radical indépendant des Vosges, et auteur des célèbres Carnets secrets, 1914-1918, n’était pas seulement le neveu mais également l’enfant adoptif de Jules Ferry.
La seconde division montre notamment les ressorts doctrinaux qui animent Jules Ferry : le positivisme, le protestantisme libéral, la franc-maçonnerie, la décentralisation, le régime parlementaire avec un contrepoids aux décisions des assemblées.
Le troisième ensemble retrace la carrière politique du personnage à Paris et dans les Vosges, avant qu’il n’accède aux responsabilités gouvernementales. On approche les raisons pour lesquelles, de façon injuste naît l’expression "Ferry famine" en 1871.
La quatrième partie s’intitule "L’homme d’état". Les chapitres s’y intitulent successivement : Les querelles de famille, Moderniser la République, Séparer l’Église et l’École : de l’instruction religieuse à la morale laïque, L’école de la République, La France d’outre-mer : l’aventure africaine, La France d’outre-mer : l’Indochine, L’impossible retour.
Les écrits personnels ou officiels sont très variés et nombreux. On retiendra ces phrases de diverses origines:
« En allant en Tunisie, [la France] faisait un pas de plus vers l’accomplissement de la tâche glorieuse que ses destinées lui ont confiée : le triomphe de la civilisation sur la barbarie, la seule forme de conquête que la morale moderne puisse admettre » (page 555)
« Mgr Freppel fait ensuite valoir que la gratuité dévaluerait l’école : peut-on accorder considération à quelque chose qui ne coûte rien ? À cela Ferry répond que l’assiduité est plus grande là où l’enseignement est gratuit (…° Alors que pour les conservateurs l’éducation est une œuvre d’assistance, pour les républicains, et ce depuis 1791, elle est un droit. C’est d’ailleurs ce que récuse Mgr Freppel lorsqu’il craint que le droit au travail ne découle logiquement du droit à l’éducation » (page 492).
« Par ce texte, le ministre, très attentif à la situation dans les campagnes, espère que l'école sera désormais considérée comme un "devoir nouveau" et que les enfants ne seront plus seulement "une paire de petits bras, mais une âme et un cœur qu'il faut élever". Pour atteindre au plus vite ce résultat, il ne recule pas devant la perspective "d’attirer par la coercition légale la masse jusque-là réfractaire de la population". Les transformations décisives de l’enseignement primaire voulues par les républicains peuvent donc entrer dans les faits » (page 497).
« [En 1887, les radicaux] réclament la "concentration républicaine", mais ils minent la République et rendent impossible tout accord en demandant la révision de la Constitution et la Séparation de l’Église et de l’État, que Ferry écarte avec force : "La suppression du budget des cultes ! Il faut ignorer l’état d’esprit de la plus grande partie de la population française pour en parler avec cette désinvolture. Vous êtes, Messieurs, des républicains très libres d’esprit, très avancés, mais vous connaissez nos campagnes, vous savez l’emprise des habitudes, des traditions. Supprimer le budget des cultes, retirer au clergé les églises, jeter les prêtres dans la rue, même en pays républicain – et que dire des départements de l’Ouest et du Centre ? –, c’est évoquer un ébranlement généra, une irritation des consciences, dont un gouvernement sérieux ne doit pas se faire un jeu" » (page 630).
Jules Ferry en 1891 : « "On est, je le répète, infiniment plus touché de ce problème [de la question sociale] que des thèses, naguère si débattues, sur le règlement doctrinal et idéal des relations de l’Église avec l’État". On mesure l’importance de ce propos quand on sait que quatorze ans plus tard, les radicaux prendront pour cheval de bataille la séparation de l’Église avec l’État, tout en réprimant les grèves et abandonnant l’essentiel de leurs projets sociaux » (page 661).
Pour tous publics Aucune illustration