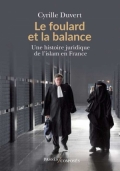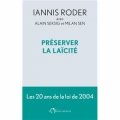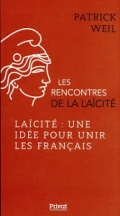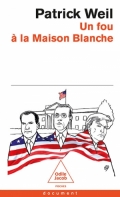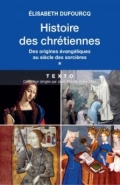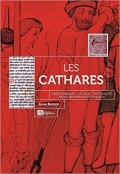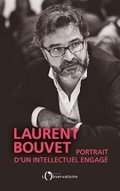Avis de Benjamin : "La connaissance de cette histoire qui nous fait compatriotes est aussi une condition de la laïcité"
La première édition de l’ouvrage De la laïcité en France date de 2021. Patrick Weil est un universitaire dont les recherches portent sur la laïcité, la nationalité et les migrants. Il a notamment été chef de cabinet du secrétariat à l’immigration en 1981 et membre du Haut Conseil à l’immigration de 1996 à 2002. Il a été membre de la Commission Stasi, nommée par Jacques Chirac afin de réfléchir en 2003 sur l’application du principe de laïcité.
Le livre De la laïcité en France est court mais a une dimension pédagogique tant sur les évènements qui amenèrent au vote de la loi de 1905 que sur les conséquences directes ou indirectes de celle-ci, que sur les questions qu’elle soulève aujourd’hui, que sur en quoi la laïcité américaine est bâti sur des idées totalement différentes de la laïcité française.
Le rôle de Louis Méjan dans l’élaboration et l’application de la loi de Séparation est souligné, on retrouve d’ailleurs la mise en exergue de ce personnage dans la bande dessinée Laïcité: Comment la loi de 1905 fut votée ?. Avant le vote de cette loi, nombre mesures se sont succédées comme avec la fin du repos dominical obligatoire, la sécularisation des cimetières, la suppression des prières publiques au Parlement afin de demander à Dieu de guider les travaux, le loi sur le divorce, le retrait d’emblèmes religieux aux tribunaux, la liberté des funérailles, la fin de la dispense du service militaire pour les séminaristes et bien entendu l’école laïque et obligatoire.
En rappelant, au moyen d’une citation tirée de l’ouvrage Sur la démocratie. Neuf conférences commis par Georges Clemenceau, que c’est la protestation formulée par le pape autour de la visite de la République française au roi d’Italie qui déclencha le processus irrémédiable, Patrick Weil avance que la laïcité est en lien avec la souveraineté de la France et du peuple français. La laïcité a deux dimensions, le premier est l’absence de lien entre foi et loi, le second est que les Églises sont libres dans le cadre juridique fixé par la loi de la République. Par contre le Concordat était un traité avec une puissance étrangère.
Deux chapitres sont consacrés aux conflits, sur le territoire hexagonal, entre l’Église et certains représentants de l’État. Processions, tenues de messes sans déclaration et sonneries de cloche ont pu être interdites dans certaines communes ainsi que la question de l’inventaire des objets cultuels d’un côté, attaque d’instituteurs publics pour avoir tenu des propos anticléricaux , refus de sacrements aux parents d’enfants scolarisés dans l’enseignement public et appel à refuser certains livres pour les élèves plus des incitations d’évêques à désobéir aux lois de l’autre côté.
Patrick Weil consacre un chapitre à l’évolution de l’Église catholique autour des lois laïques depuis les années 1920. La question du rapport de divers cultes à la laïcité, en particulier l’islam et les Témoins de Jéhovah fait l’objet du chapitre suivant. La gestion des aumôneries, des émissions religieuses radiodiffusées ou télévisées, des demandes de repas alternatifs dans les cantines sont évoquées. Par la suite sont présentés les problèmes du port du voile tant en milieu scolaire que pour des employés d’entreprises privées en contact avec le public. Pour les questions hexagonales, on termine avec le sujet des crèches et des statues à caractère religieux dans l’espace administratif ou l’espace partagé (celui commun à tous comme ici une place) et les limites à la liberté d’expression. Pour l’auteur, il est nécessaire de maintenir un équilibre nécessaire entre la liberté d’expression et les libertés religieuses, dans des limites juridiquement définies.
De la conclusion du volet autour des rapports entre les religions et l’État aux USA, on note que : « dans le triangle entre l’individu, le groupe religieux et l’État, la puissance publique apparaît en France de par l’histoire de sa relation avec l’Église catholique, plutôt comme le protecteur de l’individu contre les potentielles pressions du groupe religieux, alors qu’aux États-Unis, fondés par des groupes religieux ayant fui la persécution d’État (en particulier d’Angleterre), les groupes religieux sont perçus comme les protecteurs de l’individu par rapport à des intrusions de l’État » (page 100).
Dans la conclusion générale de cet ouvrage, Patrick Weil appelle à une relecture attentive de la loi de 1905 afin de s’attaquer aux violences religieuses ou antireligieuses trouvant parfois des prolongements dans des discriminations, et à s’opposer à toute contestation des lois de la République.
Pour connaisseurs Aucune illustration