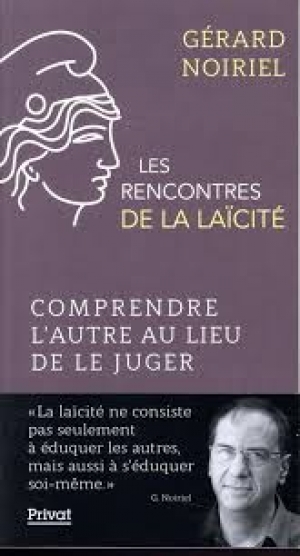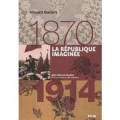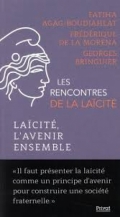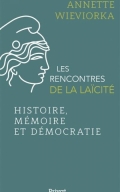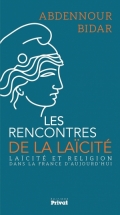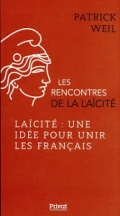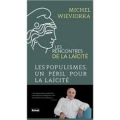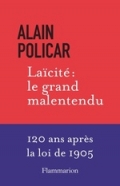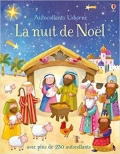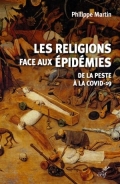Avis de Benjamin : "Au nœud de la liberté, de l’égalité et de la fraternité se fonde bien sûr la laïcité"
Georges Méric, en tant que président du Conseil départemental de Haute-Garonne en 2019 (année où s’est tenue cette conférence-débat pour la Journée de la laïcité) assure la préface. Il conclut ainsi : « la République est notre volonté, la République est notre devoir, notre avenir, notre espérance. Là est notre combat commun, celui de la liberté par l’émancipation contre l’aliénation et l’oppression, celui de l’égalité dans le respect mutuel et le partage contre la xénophobie et la cupidité, celui de la fraternité dans l’empathie contre l’intolérance et le fanatisme. Et au nœud de la liberté, de l’égalité et de la fraternité se fonde bien sûr la laïcité pour asseoir la concorde et ainsi faire éclore plus d’humanité » (page 17). Ces rencontres de la laïcité du département de la Haute-Garonne ont lieu depuis celle du 9 décembre 2015 mais dès la fin des années 1990 ce département organisait annuellement une conférence-débat pour le jour du vote de la loi de Séparation de l’État.
Gérard Noiriel s’inquiète de l’utilisation qui est faite de la laïcité par ses anciens ennemis dans le but d’exclure et stigmatiser une partie de nos concitoyens et renvoie sur ce point à l’appel du 9 décembre 2019 lancé par la Ligue des droits de l’homme, la Ligue de l’enseignement et la Libre pensée (nous ajoutons le lien pour le trouver https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/12/Appel-Laicit%C3%A9_Def-1.pdf).
Pour Gérard Noiriel, le rapport présenté par Condorcet à l’Assemblée législative les 20 et 21 avril 1792 sur l’organisation générale de l’Instruction publique joue un rôle essentiel dans la lis en place des lois laïques au début de la IIIe République. Il passe ensuite les apports d’Auguste Comte et Émile Durkheim dans l’idée que la raison et le savoir entrent dans un processus d’émancipation.
Cependant les idées des positivistes (qui croyaient au progrès social grâce au développement scientifique) sont battues en brèche. « Les dirigeants de la IIIe République avaient cru que grâce aux lois sur l’école et sur la liberté de la presse tous les citoyens français rejoindraient la corporation des "gens de lettres", pour intervenir directement, eux aussi, dans la vie publique nationale. Mais l’instruction publique ne pouvait pas, à elle seule, éradiquer les inégalités entre les classes sociales. Des voix de plus en plus nombreuses s’élèvent alors pour dénoncer les injustices du système scolaire républicain » (page 42).
Paradoxalement c’est la liberté de la presse et le développement de l’instruction (déjà dynamique sous le Second Empire) qui a permis la diffusion d’une presse antisémitisme dont un fleuron fut La France juive d’Édouard Drumont publie cinq ans après le vote de la loi de liberté de la presse. Alphonse Daudet intervient pour que Le Figaro fasse un compte-rendu en première page de l’ouvrage qui jusque là avait eu une diffusion confidentielle. Il s’en suit une série de procès et de duels entre Drumont et les nombreuses personnes qu’il met en cause dans son livre. L’antisémitisme devient une alternative au discours de la lutte des classes. À une question économique et sociale est proposée une réponse identitaire.
Les journaux accordent une place importante aux faits divers. L’accès à la sphère publique est détourné vers un récit de péripéties de la vie politique en une suite d’évènements anecdotiques. Gérard Noiriel reprend la formule de Pierre Bourdieu : « Les faits divers sont aussi des faits qui font diversion ».
Gérard Noiriel fait un parallèle entre les écrits de Zemmour et ceux de Drumont. Il écrit : « les attentats terroristes des criminels se réclamant de l’Islam ont remplacé les scandales financiers et les duels du soir à la télévision ont remplacé les duels à l’épée ou au pistolet » (page 59). L’auteur clôt son propos en soulignant que les discours de haine s’appuient sur le registre émotionnel. C’est pourquoi il s’est personnellement engagé dans le collectif DASA (association d’éducation populaire) pour mettre en scène une pièce de théâtre autour du clown Chocolat, un personnage phare de la Belle Époque). Selon lui le trouble émotionnel peut inciter des spectateurs à se poser des questions et à chercher des réponses dans des livres.
L’échange avec la salle fut conséquent, puisque, chose exceptionnelle dans cette collection, il atteint trente-neuf pages. Il est vrai que les questions fusent autour du racisme, de l’antisémitisme (et de l’instrumentalisation qui est faite de l’accusation d’antisémitisme par ceux qui critiquent le sionisme), de l’islamophobie et de l’histoire dans les médias.
Pour tous publics Aucune illustration