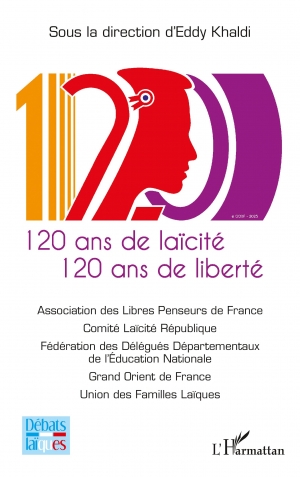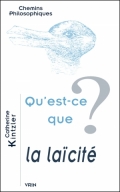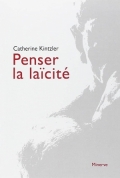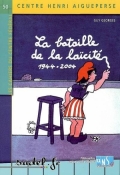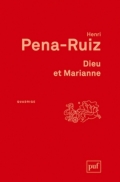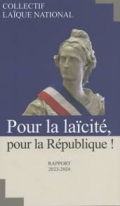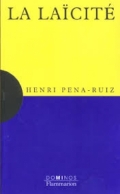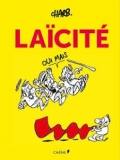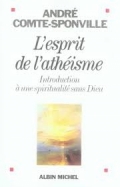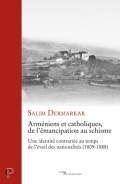Avis de Xirong : "Une loi à portée émancipatrice"
Cet ouvrage est le fruit d’un colloque tenu au Sénat le 24 février 2025. Cette manifestation a été portée par certaines associations réunies au sein du Collectif laïque national fondé en 2011. Ce sont l’Associations des libres penseurs de France (à ne pas confondre avec la Libre Pensée), le Comité-Laïcité-République, la Fédération Nationale des Délégués Départementaux de l'Education Nationale (FNDDEN), le Grand Orient de France (GODF) et l’Union des familles laïques (UFAL). Chacune des ces association est présentée en fin d’ouvrage.
Charles Arambourou (qui fut enseignant avant de devenir Premier Conseilles des chambres régionales des comptes, s’exprime ici au nom de l’UFAL) livre le résumé du rapport du Collectif laïque national. Ce texte critique certaines décisions du Conseil constitutionnel et en particulier celle touchant au non-respect de l’interdiction de subventionner les cultes et à son habitude certains propos tenus par des membres de l’Observatoire de la laïcité et de la Vigie de la laïcité. Il dresse le tableau de dix points préoccupants. Il s’inquiète du rôle de collaborateurs du service public reconnu aux aumôniers, de la présence de crèches dans des bâtiments publics, la mise en avant de contenus racialistes et d’affiches religieuses à l’université, la demande d’avocats de porter des signes religieux, le port du voile par les sportifs…
Jean-Paul Scot décortique les tentatives d’interprétation des certains articles de la loi de 1905 venus de divers cultes, parfois au nom d‘une laïcité positive. Charles Coutel informe que c’est à l’initiative du député communiste Étienne Fajon (d’ailleurs préciserons personnellement, ancien de l’École normale d’instituteurs de Montpellier, fils d’un viticulteur et d’une institutrice de l’Hérault) que le principe de laïcité fut inscrit dans la Constitution de la IVe République. Pour lui, la laïcité est portée par un humanisme et émancipatrice. La loi de 1905 est historique, dans le sens défini par Kant, car elle est remémorative, démonstrative et pronostique.
Marie-Françoise Bechtel livre une communication intitulée "La laïcité, un combat inachevé". Elle illustre par divers exemples que la laïcité française est aujourd’hui menacée dans l’hexagone où « elle baigne dans une société consumériste, différentialiste, dans laquelle "mon choix", "ma différence" fonde une revendication permanente « (page 45). D’autre part, elle a connu des dérives notamment à l’initiative de la Ligue de l’enseignement, d’après notre auteure. La laïcité a subi alors une phase d’adjectivation, on s’est mis à parler de laïcité ouverte, tolérante ou plurielle. La laïcité est française est mal comprise à l’étranger et on vit notamment en 2023 António Guterres, le francophone secrétaire général de l’ONU, ancien premier ministre socialiste portugais (mais aussi il est vrai militant à la Jeunesse catholique sous Salazar) tenir au sujet des droits des femmes le propos qu’il y a des pays où elles sont trop voilées et d’autres où elles ne le sont pas assez (page 46). Le modèle communautariste s’est largement installé dans de nombreux états.
Frédérique de La Morena fournit un texte dénommé "Les acquis de la Séparation". Dans ses antépénultienne et avant-dernière phrases , on peut lire « La laïcité est de nature juridique, elle ne peut être fondée sur la notion de tolérance, la règle de droit étant incompatible avec elle. Si la tolérance vise à faire coexister des opinions, la laïcité cherche les conditions de possibilité de cette coexistence » (page 52). La contribution d’Henri Peña-Ruiz est intitulé "Douze repères pour la défense et la promotion de l’émancipation laïque". Parmi ces affirmations, nous avons relevé celles qui suivent. « Le cadre d’une nation multiculturelle ne peut pas être lui-même multiculturaliste. Il ne peut donc pas juxtaposer plusieurs normes soumises aux particularismes coutumiers et religieux ». (page 57). « La séparation laïque a une portée émancipatrice. En effet elle délivre la loi commune de la loi religieuse qui a longtemps sacralisé, entre autres, la hiérarchie des sexes, la réduction de la sexualité à la procréation, la pénalisation de l’homosexualité, la censure de l’art et de la science » (page 56). « La tentative de captation identitaire de la laïcité par le Rassemblement national n’est pas crédible » (page 58).
Catherine Kintzler livre le texte "L’atomisme de l’association politique laïque". Au milieu de celui-ci, on notera : « L’atomisme découle du lien politique tel que le conçoit cette république laïque. La thèse laïque suppose que l’association politique ne prend pas le modèle sur le lien d’adhésion à des croyances préalables. Ce n’est pas un regroupement moléculaire de communautés qui seraient logiquement ou chronologiquement antérieures à cette association, mais u rassemblement d’individus » (page 62). Thierry Mesny (président de l’Associations des libres penseurs de France et par ailleurs directeur du département Culture Générale au Pôle Universitaire Léonard de Vinci, un établissement privé financé essentiellement par des fonds publics, surnommée à l’origine "la fac Pasqua") dresse un panorama historique des différences étapes de l’émergence de la liberté de conscience dont la première apparition est une des conséquences de la Réforme au XVIe siècle.
Gilbert Abergel, président du Comité Laïcité République, rappelle quelques questions toujours d’actualité comme le financement de l’enseignement privé, le port de signes religieux dans les compétitions sportives ou la fin de vie. Il rappelle au passage que le sénateur radical de gauche Henri Caillavet du Lot-et-Garonne de 1967 à 1983 fut un des membres fondateurs de son association (fondée en 1989, suite à l’Affaire des foulards de Creil). On enchaîne justement avec Olivier Falorni (un temps député radical) autour de la fin de vie, rajoutant d’ailleurs qu’au Sénat ce fut Henri Caillavet le rapporteur de la loi de législation de l’IVG. Michel Seelig qui fut président du Conseil de l’IUT de Metz et est actuellement membre des Conseils d’Administration du Comité Laïcité République et de Égale (présidée par l’ancienne sénatrice radicale de gauche puis Mouvement radical Françoise Laborde). Il évoque les régimes dérogatoires des cultes tant en Alsace-Moselle que dans les territoires d’outre-mer.
Eddy Khaldi, qui eut des responsabilités au sein du syndicat des enseignants de l’UNSA et à l’UNSA éducation, est président de la Fédération Nationale des Délégués Départementaux de l'Education Nationale (FNDDEN) depuis quelques années. Il évoque le dualisme scolaire et les diverses décisions gouvernementales ou législatives qui ont favorisé le développement de l’enseignement privé. Il voit là des problèmes débouchant sur des questions de mixité sociale, de démantèlement de l’Éducation nationale et de remise en cause de la laïcité française.
Nicolas Penin, également adhérent au syndicat des enseignants de l’UNSA, est aujourd’hui Grand Maïtre du Grand Orient. Il évoque son souhait de constitutionnalisation des articles 1 et 2 de la loi de 1905. Rappelons que dans le premier cas il s’agit de « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public » et dans la seconde situation de « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3 ». En annexe, ce sont d’ailleurs les 44 articles de la loi de Séparation qui sont reproduits. Ils sont signés principalement par Émile Loubet (président de la République), Rouvier (président du Conseil), Bienvenu Martin (ministre de l’Instruction publique) et F. Dubief (ministre de l’Intérieur).
Pour connaisseurs Aucune illustration