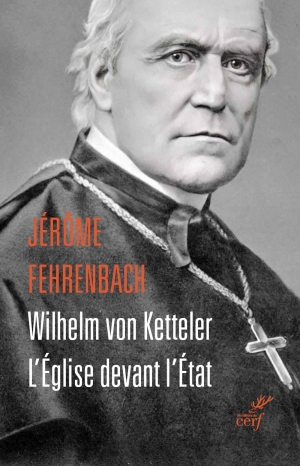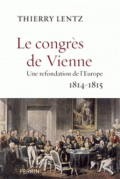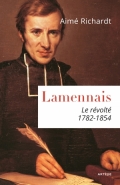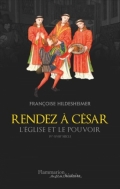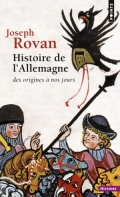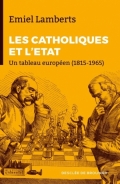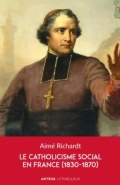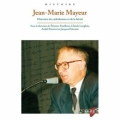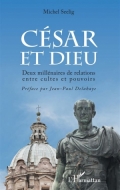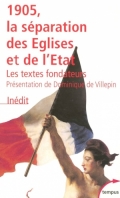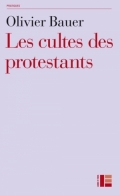Avis de Benjamin : "Lois laïques en France, Kulturkampf en Allemagne: pas le même niveau de violence"
Wilhem von Ketteler est né le 25 décembre 1811 à Münster et mort le 13 juillet 1877 à Burghausen (une petite ville de Bavière) de retour d’un voyage à Rome. Il est issu d'une famille catholique qui a largement servi les évêques de Münster (la fondation de l’évêché remonte à 805) qui possèdent le plus vaste territoire ecclésiastique de l’Allemagne.
Ordonné prêtre à Münster le 1er juillet 1844, il est élu député en 1848 à l’éphémère parlement de Francfort. Il a été évêque catholique de Mayence de 1850 à 1877 où il s’engage à lutter contre la misère de certains de ses ouailles, ce qui lui fait obtenir le qualificatif d'Évêque social. Mgr von Ketteler est membre au Reichstag en 1871-1872. Il fut l'un des fondateurs du parti politique catholique Zentrum (ancêtre de la CDU) et à ce titre s'opposa à la politique du Kultuurkamf menée par le chancelier Otto von Bismarck.
Pour comprendre ce qui suit, il faut savoir que quelques départements de l’Empire français (comme la Lippe avec préfecture Münster) ou partie du territoire de la Confédération du Rhin (comme le duché de Berg) reviennent, après le Congrès de Vienne de 1814-1815 aux Hohenzollern. Wilhem von Ketteler commence à s’opposer à la Prusse alors qu’il est conseiller référendaire auprès de la préfecture de Münster avec donc un regard sur les comptes publics et la bonne ou mauvaise administration de cet espace. Il occupe cette fonction depuis 1835 et demande un congé de six mois prolongé par une démission pour protester du fait que l’archevêque de Cologne Clemens August ait été mis en résidence surveillée en novembre 1837, suite à son opposition à la loi prussienne qui fait protestant tout enfant issu d’un mariage où un seul conjoint l’est. Frédéric-Guillaume V, après avoir vu nombre de notables catholiques boycotter son voyage de début de règne, revint sur cette obligation mais n'autorisa pas l'évêque à reprendre ses fonctions.
Fin avril 1839, Wilhem von Ketteler part pour Munich puis voyage en Bavière, Suisse et Bohême. Il rencontre, Karl August von Reisach alors évêque d'Eichstätt, avant de devenir archevêque de Munich, Il est aussi antimoderniste que l’est le pape de cette époque, à savoir Grégoire XVI. Mgr von Reisach permet à Wilhem von Ketteler d‘entrer au séminaire de Munich en novembre 1841, ce dernier a pratiquement trente ans.
Wilhem von KettelerIl est ordonné prêtre à la fin du printemps 1844 et est affecté dans un village du pays de Münster. Fin 1846, il est dans un gros bourg, près de la frontière hollandaise, où sévissent typhus et disette, il organise la solidarité. Ses actions joueront un rôle dans son élection au Parlement de Francfort en 1848, il a battu un protestant libéral. 39 ecclésiastiques sur 812 font partie de cette assemblée où siègent d’ailleurs des Autrichiens.
De retour dans sa cure, après la dislocation du Parlement, Wilhem von Ketteler entend profiter, comme l’ensemble de l’Église catholique, de la jeune liberté d’association pour mobiliser les laïcs. Pour lui la crise sociale vient que « l’indifférence à Dieu a entraîné l’indifférence au prochain » (page 163) et des conditions dans lesquelles le libéralisme économique met sous tutelle les travailleurs (pages 261-262). Devenu évêque, il a des contacts avec le leader socialiste Lasalle et ce dernier vante lors d’un meeting, deux mois avant de mourir, certaines réflexions contenues dans l’ouvrage de Wilhem von Ketteler, à savoir La Question ouvrière et le christianisme. Le Dictionnaire Maitron précise: « il retenait de la doctrine de Lassale l’idée des coopératives de production, sinon celle de l’aide de l’État, qu’il n’adopta que plus tard. Ce n’est en effet qu’en 1869, à l’occasion d’un meeting à Offenbach, puis d’un discours à la conférence épiscopale de Fulda, qu’il se prononça pour un programme d’émancipation de la classe ouvrière qui comportait, outre le droit syndical accompagné du droit de grève, une législation d’État prévoyant l’élévation des salaires, l’abréviation de la journée de travail, le respect des jours fériés, l’interdiction du travail des enfants, des mères et des jeunes filles. Sa politique sociale ne visait pas la destruction du système capitaliste, mais l’intégration de la classe ouvrière dans l’État.»
En août 1849, il démissionna de sa charge lorsqu'il fut nommé prévôt de Sainte-Edwigeà Berlin et délégué du prince-évêque de Breslau pour le Brandebourg et la Poméranie, mais le 15 mars 1850, Wilhem von Ketteler est nommé évêque de Mayence. Même si les fidèles du pape sont très dominants à Mayence, globalement le diocèse compte plus de protestants que de catholiques et le nombre de juifs y est notable. Il fonde plusieurs instituts religieux de Frères et de Sœurs pour œuvrer notamment dans les divers organismes éducatifs (dont des écoles primaires et collèges paroissiaux), orphelinats et foyers d’accueil qu'il a créés. Face à la laïcisation des écoles communales, la contre-offensive menée par l’évêché est exposée autour de la page 230. Wilhem von Ketteler va transférer la faculté de théologie de Giessen (foyer d’idées modernistes pilotées par Leopold Schmid qui condamnait l’oubli du véritable enseignement évangélique) à Mayence. Il veilla à la moralité et la discipline des prêtres de son diocèse.
Le nouveau pape Pie IX est devenu conservateur après les évènements de 1848 et on lui devra le dogme de l’Immaculée Conception, celui de l’Infaillibilité papale (idée à laquelle s’oppose notre évêque au concile) et le Syllabus. Pie IX était désarmé sur des questions telles que l'aliénation de l'Église et de l'État en Allemagne, en Autriche et en Suisse ainsi que sur les problèmes sociaux liés à l’industrialisation. Wilhem von Ketteler apporte un soutien très actif à tous les évêques allemands en conflit avec leur souverain, dont l’évêque de Fribourg avec le grand-duc de Bade sous l’emprise d’Otto von Bismarck, ministre plénipotentiaire du roi de Prusse à la Cour de Karlsruhe.
Wilhem von Ketteler était favorable à une Grande Allemagne fédérée autour de l’Autriche, ce qui donnerait dans ce cadre un poids très conséquent au catholicisme. En 1866, la Prusse annexe Giesen dans le grand-duché de Hesse-Darmstadt et en 1871 le grand-duc doit accepter que son territoire soit intégré à l’Empire allemand. Wilhem von Ketteler est un des 65 députés du Zentrum (sur près de 300) en 1871 au Reichstag. Dans son premier discours à la Chambre, notre évêque demande à l’empereur de tout faire pour restaurer les États de l’Église, ce qui est très mal perçu par ce dernier. Comme dans le canton de Genève, lorsqu’ils sont minoritaires, les catholiques allemands prônent la liberté religieuse. Bismarck voit d’un mauvais œil les catholiques de l’empire, réserve d’opposition qu’ils soient allemands (à l’ouest, au sud et à l’est du pays), alsacien-lorrains ou polonais (en 1875 sur 42 millions d’habitants, 15 sont catholiques). Tout ecclésiastique qui exprimerait une opinion mettant en cause l’ordre public est passible d’une peine de prison de deux ans, cette mesure restera en vigueur sous le IIIe Reich.
Quoique démissionnaire de son mandat de député en avril 1872, l’évêque de Mayence continue à s’exprimer dans la presse contre la politique de laïcité et d’absolutisme monarchiste. Bismarck répond en accusant en particulier l’Église catholique de confondre liberté et souveraineté temporelle. Il prend un certain nombre de mesures, instaurant le mariage civil, la fin l’inspection des écoles publiques par le clergé, et sanctionnant les ecclésiastiques au niveau fédéral qui ne respecteraient pas ou ignoreraient certains aspects de la législation. De plus dans le territoire de la Prusse tous les ordres religieux, à l’exception de ceux hospitaliers, sont dissous et leurs biens confisqués (y compris les bâtiments scolaires leur appartenant), les jésuites sont interdits d’enseignement et ferment aussi les petits séminaires. Certaines de ces mesures (et d’autres non cités) propres à la Prusse sont reprises dans des États allemands ayant des souverains protestants comme le Grand-duché de Hesse (avant 1815 la Hesse-Darmstadt) ou le Pays de Bade. Wilhem von Ketteler est donc concerné non seulement pour la partie de son diocèse relevant de la Prusse mais également pour l’autre dépendant de la Hesse.
L’archevêque de Cologne est mis en résidence surveillée, comme un de ses prédécesseurs. Les sanctions pleuvent tant sur les curés que les évêques ou ceux qui semblent avoir soutenu les propos des premiers. « En 1877, six des douze évêques catholiques résidant en Prusse auront été destitués de leurs fonctions par décision de justice. En 1881, on estimera qu’il manque 1 770 prêtres et auxiliaires en Prusse et 601 paroisses sont vacantes » (page 330). Wilhem von Ketteler en vient à souhaiter une Séparation de l’Église et de l’État (page 332).
Cependant le Kulturkampf prend fin avec l’arrivée de l’année 1879, Bismarck se montre prêt à négocier avec l'Église. Il a en effet constaté que l’ensemble des catholiques ont voté pour le Zentrum qui a fortement progressé et désire maintenant réprimer les idées socialistes par une sévère législation (je n'ai pas trouvé cette dernière information, à mon regret). La conclusion du livre ouvre sur le rôle de l’Église comme contre-pouvoir dans la vie d’une société sécularisée. L’auteur juge la laïcité oppressant de nos jours, une opinion que ne partageront pas nombre des lecteurs français de ce titre et ceux qui la partageront pourraient bien être autant catholiques que musulmans.
Pour connaisseurs Quelques illustrations