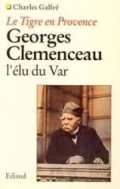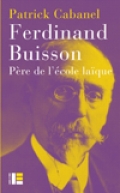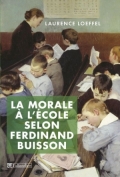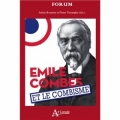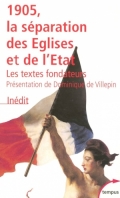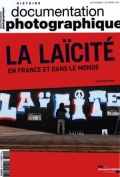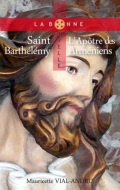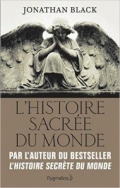Avis de Benjamin : "Un bréviaire pour une pratique de coexistence"
Jean Baubérot-Vincent se donne pour mission ici de fournir les clés afin de comprendre les étapes qui ont amené de 1882 à 1905 la République française à se donner un socle laïque reposant essentiellement sur les lois laïcisant l’école publique et la séparation des Eglises et de l’Etat. Il mène son propos à travers les chapitres suivants : L’école, un enjeu majeur de laïcité, La morale laïque : former un citoyen libre, Proposition de la loi de 1905 : le conflit entre deux laïcités, La fabrication de la loi (I). Une séparation qui "ne contente personne", La fabrication de la loi (II). La prévalence de l’éthique de responsabilité, L’application réussie de la loi… malgré les quatre refus de Pie X, 1882 et 1905 face aux défis du XXIe siècle. Il y a en plus des annexes, dont l’une est une chronologie courant d’août 1789 avec la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen au 5 février 2022 date de la création du Forum de l’islam de France (FORIF). On apprécie l’existence d’un index des noms propres que ce soit de personnes ou de lieux.
L’objectif est de montrer que la laïcité peut s’imposer dans l’hexagone car elle fut pacificatrice. Ceci se fit alors que les quatre refus successifs des lois françaises par Pie X, pouvaient entrainer la fermeture des églises. L’objectif du pape était de faire apparaître la République comme persécutrice et par là renforcer la foi catholique en France face à une adversité de l’État largement provoquée par une mise en scène des milieux cléricaux. Cette possible dénonciation d’intolérance aurait pu se nourrir auprès d’une laïcité dominatrice se qualifiant elle-même de "laïcité intégrale" dont le porte-parole fut le socialiste Maurice Allard (député du Var en 1898-1910 de la circonscription de Draguignan dont Clemenceau fut député de 1889 à 1893).
Dans le dernier chapitre, il dit craindre qu’une une laïcité paraissant discriminante face à l’islam, du fait de la succession de certaines, à savoir celles lois de 2004, 2010, 2016 et 2021 ne fassent le jeu de l’islamisme radical. Le contenu de cet ouvrage est très riche, ainsi dans le chapitre consacré à la morale laïque sous la Troisième République, Jean Baubérot-Vincent a-t-il analysé tant le contenu de cahiers d’élèves que celui de certains passages que celui de La Grande Encyclopédie de Marcellin Berthelot, du Dictionnaire de pédagogie de Buisson ou du Tour de la France par deux enfants de G. Bruno (dans ses deux versions).
Il en profite pour citer la succession de lois de libertés, dans lesquelles on trouve notamment les libertés syndicales, la liberté de réunion, la liberté de la presse, le retour de l’autorisation de divorcer, la libéralisation des funérailles de l’emprise cléricale. Avec le contenu du chapitre autour de la préparation de la loi de 1905, on mesure chez Émile Combes tant les conséquences de sa lutte contre les congrégations que sa vision d’un renforcement d’un Concordat au lieu d’une Séparation. On perçoit le rôle en amont de Francis de Pressensé dans ce temps qui précède le vote de la loi. On voit également combien des groupes de femmes, toujours non-électrices, deviennent actrices dans leur opposition ou dans leurs engagements en faveur de la loi.
Pour connaisseurs Aucune illustration