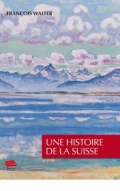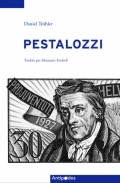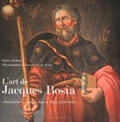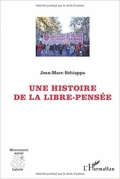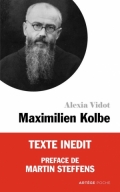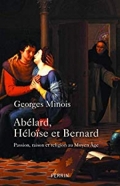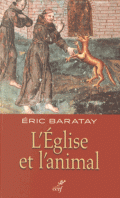Avis de Benjamin : "L‘étude de la religion dans l’école publique tessinoise"
L’ouvrage, sous-titré Pluralité des logiques dans le canton suisse du Tessin Pluralité des logiques dans le canton suisse du Tessin, rappelle combien l’enseignement de la religion catholique dans les écoles publiques fut une histoire sur la longue durée dans ce canton italophone. Les guerres successives menées par la Confédération helvétique contre le duché de Milan font que la région qui va constituer le canton du Tessin va tomber dans l’escarcelle des cantons suisses. Ceci se fait en deux temps, le premier à la fin du XVe siècle et par la suite au début du XVIe siècle. La Constitution de la République helvétique du 12 avril 1798 créa deux cantons qui furent réunis en le seul canton du Tessin en 1803.
Aujourd’hui cet espace regroupe un peu plus de 4% de la population helvétique. Du point de vue religieux, en 2023, plus de 30% des Tessinois se disaient sans religion (en 2010, ils n’étaient que 16%), 56% se réclamaient du catholicisme (en 2010 ils étaient que 69% et en 2000 ils étaient 76%), 9% se disaient chrétiens non catholiques (autant qu’en 2010), les musulmans atteignaient 2 ,2% (soit une progression de 0,4% en treize ans), les juifs étaient restés stables à 0,1% et les adeptes d’autres religions se trouvaient à 0,8% (soit une progression de 0,2%).
La première loi sur l’école au Tessin date de 1804, elle ne mentionne pas d’enseignement religieux mais les écoles villageoises sont sous l’autorité des curés. Les libéraux profitèrent donc de leur période de gouvernement de 1839 à 1875 pour mener une politique de laïcisation de la société : séparation de l’Église et de l’État votée en 1855, fermeture des monastères, exclusion du clergé de l'enseignement et suppression des collèges religieux. Parallèlement, l'instruction publique fut renforcée. La lutte contre l'analphabétisme impulsée par Stefano Franscini, dans les années 1840, se transforma en une politique plus résolue d'éducation populaire qui se traduisit également par le renforcement des écoles secondaires cantonale. Toutefois en 1875, le parti conservateur reprit la majorité. Ceci ne fut pas sans certaines conséquences, car cela permit de :
« 1. garantir la liberté d’enseignement, c’est-à-dire la possibilité d’instituer et de fréquenter les écoles privées (art. 1 : « L’insegnamento è pubblico o privato » ; art. 241 : « Un istituto privato di scuole secondarie potrà essere parificato alle scuole pubbliche di ugual grado, quando avrà
ottenuto dal governo l’approvazione dei propri statuti […]. ») ;
2. permettre à nouveau que le personnel de l’Église puisse exercer dans l’enseignement ;
3. réintroduire l’instruction religieuse dans les plans d’études de tous les ordres scolaires, en précisant que l’autorité de l’Église veille sur l’enseignement religieux (art. 6 : « L’autorità ecclesiastica veglia sull’insegnamento religioso ») » (pages 34-35)
L’expérimentation des cours d’histoire des religions, en lieu et place des doctrines catholiques ou évangélique réformée, se fit au Tessin entre 2010 et 2014. Du fait de l’opposition de la hiérarchie catholique locale, y eut finalement un maintien des anciennes pratiques marquées par la possibilité de voir les élèves dispensés des cours délivrés par les ministres du culte. Intégrer, dans l’éducation scolaire, l’approche historique et culturelle des mondes symboliques, religieux et non religieux, ne se fait pas sans réserves. Ainsi « Du côté catholique, on estime que le fait religieux ne peut être abordé que dans une perspective interne, car la compréhension du religieux ne serait accessible qu’à travers la foi. Une déclaration du cardinal Lustiger lorsqu’en France a émergé l’idée d’un cours d’Histoire des religions, illustre cette thèse : " Cette idée d’un cours d’Histoire des religions, remplaçant, ou risquant de remplacer, l’initiation à la foi et à la vie chrétienne par une étude prétendue scientifique et neutre des religions me semble une parfaite utopie et même une espèce de phantasme qui ne ferait qu’accroître encore la désorganisation du savoir dans la pensée des jeunes" (Legros, « Mgr Lustiger : Une mutilation de la culture scolaire », La Vie,(2378), 1991, p. 63). L’étude scientifique du fait religieux ne serait donc qu’une prétention utopique et insignifiante du point de vue de l’acquisition d’un savoir organisé chez les élèves.
Du côté des libres penseurs, on estime que l’idée d’une approche externe ne représente qu’une ruse, au sens où les pouvoirs religieux chercheraient à diffuser l’enseignement religieux à travers un déguisement : ne pouvant entrer dans les écoles avec l’étiquette du « confessionnel », on le ferait par le moyen astucieux d’un enseignement qualifié de neutre et de scientifique. Il s’agit de la thèse du « cheval de Troie », illustrée de manière emblématique par Catherine Kintzler au début des années 1990: le retour du religieux dans l’école laïque se fait par l’institutionnalisation d’enseignements qui se disent scientifiques. » (page 121).
Tout au long de l’ouvrage, certaines distinctions sont faites. Ainsi peut-on lire, pages 72-73, ceci : « La distinction entre sécularisation et laïcisation se situe à deux niveaux différents de description de la réalité sociale. Le processus de sécularisation peut être défini comme le passage d’une culture religieuse plus ou moins envahissante à une configuration relationnelle où les croyances religieuses représentent un choix privé et existentiel. En revanche, le processus de laïcisation décrit la place et le rôle de la religion dans l’agencement institutionnel de l’État : « Il induit une dissociation du champ politique, comme instance de pouvoir (avec son aspect d’obligation et de coercition), et du champ religieux, comme une instance d’autorité parmi d’autres » (Baubérot, « Sécularisation, laïcité, laïcisation », Empan, 90(2), 2013, p. 37). Les autorités et les institutions religieuses, lorsqu’elles sont soumises à un processus de laïcisation, ne sont pas anéanties par la force de l’État. Elles cessent d’être des référents normatifs privilégiés et dotés d’un pouvoir de coercition, mais continuent d’exister comme des instances normatives parmi d’autres ».
La question essentielle est évidemment de savoir comment un enseignement religieux a été remplacé par des cours de l’histoire des religions et si les premiers ou les seconds ont revêtus un caractère obligatoire à une certaine époque. On relèvera à ce propos, page 74, cela « plutôt que de déclin ou de disparition des religions, il serait plus correct de parler de dérégulation institutionnelle des religions (« École et religions : une nouvelle donne ? », Revue française de pédagogie, 125(1), 1998, p. 7-20). Willaime, à côté d’une analyse descriptive de la notion de sécularisation, tient un discours en partie plus normatif, car il considère, d’une part, que la dérégulation institutionnelle de la religion produit une situation d’« anomie » religieuse – l’identité religieuse des individus est incertaine et flottante, ce qui les expose aux risques divers du marché de l’offre du salut religieux (fondamentalisme, sectes, etc.) – et, d’autre part, que face au développement de cette anomie religieuse, un enseignement rigoureux sur les grandes traditions religieuses de l’humanité est nécessaire ».
Les enseignements de contenu sont distingués en trois types : into religion, from religion, about religion. En matière de rapport aux confessions religieuses, on est respectivement avec une confession de référence, une ou plusieurs confessions de référence, l’adoption d’un regard externe id&pendant des traditions religieuses. À propos des principes méthodologiques, on passe l’un après l’autre : partage de la foi entre enseignant et enseigné, de partage des principes moraux et éthiques de différentes religions, de développement spirituel et religieux. Au sujet des finalités principales on trouve successivement d’une introduction à la doctrine et aux pratiques, de développement spirituel et religieux, de compréhension scientifique des faits religieux (page 124).
Après avoir exposé les modalités de son enquête sur les représentations en matière de représentation de l’histoire des religions, auprès de publics variés, l’auteur conclut ainsi : « L’étude de la réforme tessinoise d’Histoire des religions au prisme de la sociologie du curriculum permet d’éclairer une zone qui risquerait autrement de demeurer dans les ténèbres. Le terrain de l’enseignement d’Histoire des religions est, dans les faits, particulièrement sensible à deux facteurs d’ombre. Il y a d’abord l’ombre des intérêts politiques, car le thème de la réforme ne devient intéressant que dans la mesure où il s’agit de faire parler les arguments favorables ou contraires aux finalités poursuivies. C’est ainsi que ministres, députés, enseignants, experts, ministres du culte de tout type et membres de la société civile n’hésitent pas à s’engager de manière animée dans le débat sur le sort de l’enseignement en matière de religions. On n’observe pas le même type d’effervescence lorsqu’il s’agit des modifications des plans d’études concernant les mathématiques ou les langues !
Il y a ensuite l’ombre des soucis didactiques, ces derniers se concentrant sur les contenus et sur les approches d’enseignement en privilégiant le regard sur l’action en classe et en oubliant quelque part les implications d’ordre social et politique. Ces deux facteurs d’ombre contribuent de manière différente à négliger ce que nous avons pu, au contraire, observer : il n’existe pas un, mais des enseignements d’Histoire des religions. Des enseignements variés qui, bien que cohabitant dans un même espace, renvoient à des imaginaires éducatifs concurrents et contradictoires. » (page 312)
Ce titre, à travers la situation d'un canton de culture catholique, pose des questions essentielles et universelles sur ce que peut être l'enseignement des religions et la sécularisation de la société.
Pour connaisseurs Aucune illustration