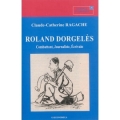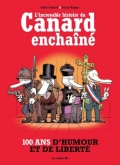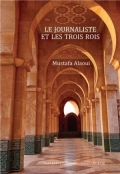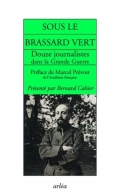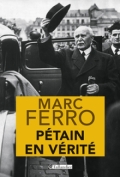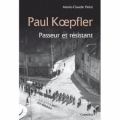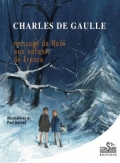Avis de Adam Craponne : "La presse française des années noires"
Il est difficile d’imaginer la richesse du contenu de ce livre et nous ne pourrons jamais qu’en fournir une piètre idée. L’ouvrage permet de connaître non seulement la presse française sous L’Occupation mais également les journaux des années de l’Entre-deux-guerres. Ainsi accorde-t-on une large place à la presse de Raymond Patenôtre d’avant-guerre qui réunit de très nombreux journaux de province aux quatre coins de la France comme notamment Le Petit Niçois, L’Express de l’Est (pour les Vosges), Lyon républicain, La Sarthe, Le Petit Havrais ou temporairement Le Petit Journal. Raymond Patenôtre jouera un jeu un peu désolant au début de l’Occupation mais, ayant la double nationalité franco-américaine, il a l’excellente idée de s’exiler aux USA en 1941, laissant son groupe de presse à Albert Lejeune, un personnage qui apparaîtra assez souvent dans cet ouvrage.
L’arrivée des troupes allemandes en juin 1940 a de lourdes conséquences pour la presse parisienne puisque une partie de ces journaux à diffusion nationale vont se replier en zone non occupée notamment à Lyon et Clermont-Ferrand. La tentative de faire reparaître L’Humanité est assez largement raconté, les Allemands n’y sont par totalement hostiles mais ce sont les autorités vichyssoises qui mettront les bâtons dans les roues. Un Paris-Soir pirate aux mains de la propagande allemande (avec un Alsacien Louis Schiesslé comme directeur général) alors que l’équipe légitime de Paris-Soir est à Lyon. On retrouve d’ailleurs un nombre non négligeable d’Alsaciens comme Eugène Gerber au poste de directeur du quotidien Paris-Soir mais aussi propriétaire de la société d’édition Théophraste Renaudot et des revues de mode Pour Elle et Notre Cœur.
Les personnalités allemandes gardant un œil sur la presse de zone occupée sont nombreuses et Otto Abetz n’est pas le seul, toutefois lui s’entoure d’une équipe de gens cultivés où on trouve en particulier Gerhard Hibbelen, Ernest Achenbach et Rudolf Rahn. Le trust que construisent les occupants est dirigé par un fonctionnaire nazi, Gerhard Hibbelen ayant travaillé dans la presse allemande nazie depuis le milieu des années vingt. Il est né à Aix-la-Chapelle et a fait des études à Bruxelles, d’où sa parfaite maîtrise du français. Ce groupe compte plus de vingt sociétés de droit français et s’appuient sur un personnel d'hommes de confiance français. Cette presse germanophile n’hésite pas à vitupérer certaines décisions du gouvernement du maréchal Pétain. Le secrétaire général des Ondes, à savoir Pierre Mariel (pseudonyme de Pierre Marie) écrit ainsi : « Pour travailler à la radiodiffusion nationale, il faut être juif ou anglophile et habiter en zone non occupée » (page 343).
La Propaganda Abteilung, relevant directement de Joseph Goebbels, ministre de la Propagande d’Hitler, ne se contente pas de surveiller les quotidiens et autres publications d’informations générales. Elle contrôle aussi les secteurs de la vie culturelle et en particulier la presse spécialisée dans le domaine de la radio (tel Les Ondes), des spectacles ou du cinéma. Ainsi les frères Offenstadt, juifs d’origine allemande arrivés dans l’hexagone sous le Second Empire et dont le patriotisme français est irréprochable, se voient confisquer leurs publications populaires prospères dont Le Film complet. Un chapitre entier est consacré à la Société parisienne d’édition, et une bonne partie de la vingtaine de pages en question évoque l’aryanisation des journaux des frères Offenstadt. On reparle de ces derniers ultérieurement autour des conditions dans lesquelles ils tâchent de récupérer leur bien après la Libération.
De nouveaux titres surgissent tel La France au travail fondée en 1940 par Georges Oltramare (sous le pseudonyme Charles Dieudonné) et Jean Drault, avec Henri Coston (farouchement antiémite et ant-maçonnique) comme secrétaire de rédaction. Jean Luchaire est aux Nouveaux Temps, Marcel Déat à L’Œuvre, Georges Suarez à Aujourd’hui, Jacques Doriot au Cri du peuple, Claude Jeantet au Petit Parisien. Au-delà des hommes phare de la Collaboration qui portent des journaux, des personnages clés bien moins connus sont mis en lumière tel Jean Fontenoy engagé lui aussi dans La France au travail mais aussi l’hebdomadaire La Vie nationale. On apprécie les biographies assez fouillées des personnes actives dans la presse de la Collaboration.
On relève de fréquentes interventions de Pierre Laval (lui-même homme de presse) dans l’orientation en particulier des journaux en zone sud afin qu’ils relaient plus la politique de Collaboration ; il joue également un rôle d’arbitre. On a un exemple très largement développé des multiples agissements du chef du gouvernement avec le cas du Petit Marseillais (dont les locaux furent récupérés par le quotidien communiste à la Libération) où à une querelle d’héritiers s’ajoute des ambitions diverses. « La décision arbitrale de Pierre Laval est signée le lendemain 17 février [1944] par Gaillard-Bourrageas, Albert Lejeune, Jean Savon-Peirron et le président de défense des actionnaires du Petit Marseillais (page 584). Le premier est condamné à mort par contumace et le second est fusillé à la Libération, par contre Jean Savon-Peirron se voit reconnaître par Charles Dubost commissaire du gouvernement d’avoir tenté de limiter l’influence néfaste des occupants et de leurs auxiliaires pour s’être opposé aux deux précédents. Toutefois les journaux communistes jugent scandaleuse cette bienveillance.
Pierre Laval arrive aussi protéger certains titres non germanophiles, porteurs d’un petit regard critique sur la politique vichyste. Ceci se fait pour diverses raisons, par exemple une amitié ancienne avec un des dirigeants du journal ou un gage pris pour un changement ultérieur de son discours en cas de victoire alliée. Le contenu du Mot d’ordre, imprimé à Marseille, est à ce titre intéressant à analyser. Ce journal a été lancé par René Gounin et Ludovic-Oscar Frossard ; ces deux-ci sont venus de la SFIO et passés ensuite à l’USR regroupant des socialistes indépendants (cartouche qu’entendait jouer Laval), de plus Frossard et Laval se connaissent depuis la fin de la Belle Époque du fait de la révocation de son métier d’instituteur qui frappa le premier pour avoir porté le drapeau rouge au cours d’une manifestation le 1er mai 1913. Ce titre compte également à la rédaction René Naegelen (d’origine belfortaine comme Frossard) qui était toujours à la SFIO en 1940. Ce quotidien nuance son vichysme et n’est pas du tout collaborationniste et antisémite (Frossard a une mère juive) ; ce journal a publié le célèbre La Rose et le Réséda de Louis Aragon en mars 1943.
Afin de pouvoir remettre les choses en place, nous citerons un long passage: « Le Mot d’ordre se veut l’interprète d’une sorte d’opposition interne du régime de Vichy : ses polémiques, ses réserves, et même ses critiques, quoique diplomatiquement formulées, attirent au Mot d’ordre menaces, rappels à l’ordre et suspension, sans que le journal perde une occasion de manifester son indépendance. Frossard applique avec habileté la recette qu’il offre à des confrères qui en usent avec plus ou moins de hardiesse et de succès : "On en arrive quand on est capable de tenir une plume, à dire l’essentiel de sa pensée sous les régimes les plus sévères. D’illustres exemples l’attestent. Les rigueurs de la censure obligent l’écrivain à avoir du talent et le lecteur à être intelligent"[Le Mot d’ordre, avril 1941]. Le Mot d’ordre se fait aussi remarquer par la qualité et la richesse de ses pages littéraires, dont Frossard confie la direction à Stanislas Fumet, la variété et le non-conformisme de ses collaborateurs, qui affichent sans précautions excessives leur hostilité à la collaboration et leurs affinités avec la Résistance » (page 493-494). Je n’ai rien trouvé par contre sur le journal La Montagne d’Alexandre Varenne (autre socialise indépendant issu de la SFIO) qui mène une critique masquée du régime de Pétain jusqu’à la suspension volontaire de sa parution en août 1943. Il est vrai que le sujet de cet ouvrage porte sur la germanophile nazie dans la presse française.
Pour connaisseurs Aucune illustration