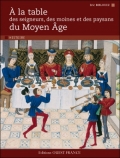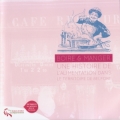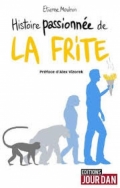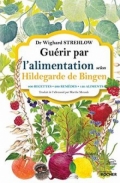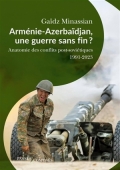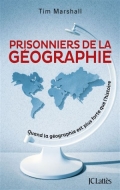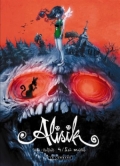Avis de Patricia : "Accorder plus de valeur à une nourriture saine et écarter une agriculture de production au moindre coût"
Les éditions de L’Atelier permettent au béotien de faire le point sur un certain nombre de sujets qui font souvent l’actualité ; il existe à ce jour une petite vingtaine de thèmes traités dans la collection "En finir avec les idées fausses sur". Les prochains porteront sur l’antispécisme (mouvement en lutte contre l'exploitation et l'utilisation des animaux par les humains d'une façon qui ne serait pas considérée comme acceptable s'il s'agissait d'humains) et l’opéra.
Le discours de Benjamin Sèze renvoie à des études dont on donne les références. Ainsi le lecteur pourra aller chercher des explications complémentaires pour les sujets qui l’intéressent. Ce titre convient tant au grand public par son texte vulgarisateur, qu’aux étudiants se destinant à des professions comme diététicien ou contrôleur alimentaire.
Dans l’introduction, on relèvera « Or, considérer avant tout que "les gens ne veulent pas bien manger", ce n’est pas à chercher à comprendre pourquoi l’alimentation saine et durable est devenue, ces dernières années, un "marqueur social" au lieu d’être un projet commun. C’est croire que l’offre ne fait que servir la demande et ne pas voir la stratégie de segmentation menée par les industriels qui ont toujours considéré les aliments de meilleure qualité comme des produits à forte valeur ajoutée, dans une logique de profit et non pas de démocratisation. C’est ne pas avoir conscience que la question de l’accessibilité sociale a longtemps été un angle mort dans le développement à l’industrie agro-alimentaire » (page 9).
Pour Benjamin Sèze « manger mieux ne peut rester une injonction faite aux consommateurs et consommatrices ou aux producteurs et productrices, c’est un projet de société. Pour imaginer un nouveau modèle, il faut percevoir les dysfonctionnements en vigueur, concevoir la possibilité d’une alternative et identifier les solutions souhaitables et les leviers potentiels » (page 11). Il explique que c’est là l’objectif essentiel de son ouvrage.
Cet ouvrage est divisé en cinq grandes parties. Sur la bonne quarantaine de sujets abordés, chacun en une demi-douzaine de pages, un de ceux très attendue était de répondre à la question "Le système actuel n’est pas parfait, mais c’est le seul valable". De façon plus anecdotique au départ, intéressera un grand nombre de lecteurs, l’interrogation "Lutter contre le gaspillage, c’est finir son assiette". En fait on verra que la très grande part du gaspillage alimentaire provient des conséquences de la loi du marché. Le problème la concurrence internationale amène 30% de la production agricole hexagonale à ne pas être rentable de récolter des produits pour les vendre. Les exigences imposés par les supermarchés, sur les prix d’achat ou certains aspects des fruits et légumes sont également responsable d’une part non négligeable de non-vente.
Le premier volet s’attache à évoquer "Cinquante nuances de bien manger", on trouvera par mi les onze points soulevés "Manger durable, c’est manger du poulet plus que du bœuf" ou "Manger durable, c’est manger local plutôt que du bio qui vient de loin". La deuxième partie est intitulée "L’illusion d’un système qui fonctionne". On relève, dans ce volet, ceci : « Laure Bonnaud, sociologue à l’Inrae, qui a travaillé sur le sujet, liste deux grandes étapes dans le processus de "normalisation" de notre alimentation pour plus de sécurité sanitaire. À la fin du XIXe siècle, l’évolution des sciences vétérinaires a permiis de mieux connaître les liens entre maladies des animaux et (in)salubrité des denrées animales. L’inspection des viandes dans les abattoirs, par des vétérinaires, devient obligatoire. Ensuite, à partir des années 1960, le développement d’un marché européen implique une standardisation commune pour rassurer les acheteurs venant des autres États membres. Parallèlement, l’apparition des supermarchés qui implique l’allongement des circuits de distribution contribue au renforcement des réglementations sanitaires. Ces politiques en faveur de la santé animale et de l’hygiène alimentaire "ont participé à la quasi-éradication en France de certaines maladies animales comme la brucellose et la tuberculose" note Laure Bonnaud » (page 66).
"Au moins en France, tout le monde mange à sa faim" est le nom de la troisième partie. Sont développés là, afin d’en souligner les contradictions, les questions suivantes : "L’insécurité alimentaire est un problème des pays pauvres", "On mange mieux à la campagne", "Lutter contre la faim en utilisant les invendus : c’est du bon sens", "En France, l’aide alimentaire subvient aux besoins des plus pauvres", "Quand on a vraiment faim, on se contente de ce qu’on nous donne", "Pour les ménages précaires, il suffit de développer une offre low cost".
La quatrième partie se nomme "Mieux se nourrir, mieux produire : Quand on veut, on peut". On a là des exemples de personnes en situation de précarité ou revenus modestes à qui il ne reste plus qu’à tenter de réduire au maximum leurs dépenses alimentaires, une fois leurs dépenses essentielles réalisées. Contrairement à certaines idées reçues, ces gens ne restreignent pas leur budget de nourriture pour des achats destiné à leurs loisirs (comme une sortie culturelle, un voyage ou du matériel audiovisuel). Quelques informations paraissant parfois spontanément perçues comme insolites arrivent, comme celle qui indique qu’en soixante ans le budget consacré à l’alimentation est passé dans les familles de près de 35% à 16%. Il aurait été bon d’avoir les chiffres pour 2024, car on sait que, depuis l’arrivée du covid et le déclenchement de la guerre en Ukraine, les prix des produits alimentaires ont sérieusement augmenté.
Le cinquième et dernier volet s’intitule "100% sain et durable : Un projet irréaliste ?". Sept affirmations (à entraver plus ou moins) suivent : "La plupart des consommateurs et consommatrices ne veulent pas aller vers une alimentation plus responsable", "Les légumes moches, les clients n’en veulent pas", "On doit produire beaucoup pour nourrir tout le monde", "Si on relocalise la production, on ne pourra pas nourrir tous les Français et Françaises", "Une alimentation de qualité et abordable n’est possible qu’au détriment des producteurs", "Les agriculteurs et agricultrices n’ont aucune envie ni aucun intérêt à ce que ça change", "Le système actuel n’est pas parfait, mais c’est le seul viable".
Pour tous publics Aucune illustration