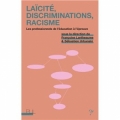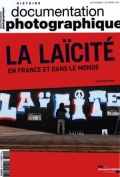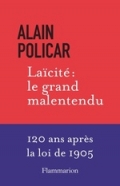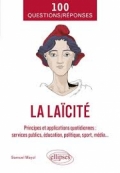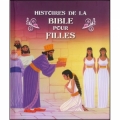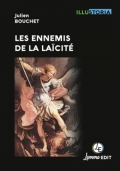Avis de Benjamin : "Laïcités sans frontière mais avec des limites"
Ce livre est sous-titré Religions et libertés dans le monde. Après une introduction de Jean Baubérot, l’ouvrage se divise en deux parties: forum et dossier. Il y a aussi des annexes, l’une d’entre elle propose par des coloriages variés de mettre en évidence les états respectant le pluralisme religieux, ceux où ce respect de pluralisme religieux est "douteux" et ceux ne respectant pas le pluralisme religieux. Sur ces cartes, il y a aussi des étoiles pour pointer des tensions religieuses dans un état. On est surpris de ne pas y voir figurer pour l’époque du tout début du XXIe siècle par exemple l’Azerbaïdjan (pour le cas du Haut-Karabagh), les Philippines ou le Soudan.
Il s’agit de voir comment la laïcité ou à défaut l’esprit de sécularisation se décline dans certains pays (Brésil, Canada, États-Unis, Italie, Royaume-Uni, Turquie, divers états de l’Union européenne). Il y a également des textes en particulier autour de l'intégrisme, le fondamentalisme, la liberté de conscience et les droits de l'homme.
Il y a seize contributions respectivement intitulées: La laïcité, une chance pour le XXIe siècle (Jean Baubérot), La laïcité à l’épreuve des droits de l’homme (Jean Baubérot), La Commission Stasi et les paradoxes de la laïcité française (Valentine Zuber), La laïcité française à l’épreuve de l’islam (Farhad Khoszrokhavar), Peut-on parler de "laïcité européenne"? (Jean-Paul Willaine), Le Royaume-Uni, un modèle communautariste anti-laïque (Grace Davie), La laïcité en Italie, pays concordataire ( Francesca Margiotto Broglio), Les États musulmans entre islamisation et laïcité (Olivier Roy), Séparation, neutralité et accommodements en Amérique du Nord (Micheline Milot), Une laïcité héritée des lumières face au foisonnement religieux: le Brésil (Roberto Motta).
Dans la partie "dossier", on découvre respectivement: Brève histoire de la laïcité en France (Jean Baubérot), Le phénomène de sécularisation (Jean Baubérot), L’intégrisme (Émile Poulat), Le fondamentalisme (Sébastien Fath), La liberté de conscience (Valentine Zuber), Les droits de l’homme (Bertrand Mathieu). On remarquera que Valentine Zuber a donné deux textes et que Jean Baubérot en a fourni quatre.
Farhad Khosrokhavar (né en 1948 à Téhéran) était alors maître de conférence et ensuite directeur de recherche à l’école de hautes études. De son texte, nous avons retenu deux passages. Le premier est: « Tout au long du XIXe siècle et de la première partie du XXe siècle, la politique venait à la rescousse des Républicains dans leur lutte contre les catholiques. À présent, ce ciment politique est remplacé par une sort de consensus médiatique traversé par beaucoup d’incertitudes et de sous-entendus non explicités: on prône une intégration assimilationniste au sein de l’espace public alors que les identités particulières en ont remis en cause une grande partie des caractéristiques. On exige aussi la conformité à une vision normative qui est suivie par un individualisme rampant de toutes parts. Ce constat a conduit certains chercheurs à vouloir "laïciser la laïcité", c’est-à-dire à l’ouvrir à l’évolution sociale et à la nouvelle donne de la société française en lui déniant le statut de sociabilité absolue que lui attribuent nombre de ses partisans » (pages 50-51).
Le second passage, sélectionné par nous, est le suivant: « L’adaptation d’une partie des nombreuses orientations culturelles françaises et celle de la société majoritaire aux nouvelles donnes religieuses sont encore à réaliser. Pour cela,une ouverture à la laïcité, au nouvel individualisme comme aux exigences de nouvelles communautés dans un débat ouvert est à l’ordre du jour. Il faut tenter de "séculariser" la laïcité ou, selon l’expression de Jean Baubérot, de la "laïciser" à son tour, pour l’adapter aux nouvelles donnes de la laïcité française » (page 52).
Cinq ans plus tard, Farhad Khosrokhavar reprendra cette dernière idée en déclarant: « j’affirme que la laïcité dans sa tournure récente (que j’appelle « néo-laïque » ou « laïciste ») a pris un virage « religieux », qu’elle est devenue une « religion civile » alors que par le passé, elle ne l’était point. Sa pointe acérée dirigée contre les musulmans favorise entre autres, leur radicalisation. Elle n’est certes pas le seul facteur, loin de là. Comme j’ai essayé de le montrer amplement, la structure urbaine comme les banlieues et les quartiers pauvres et enclavés — « l’urbain djihadogène » —, la situation socio-économique (l’exclusion sociale et la stigmatisation), la structure familiale (la crise de la famille), l’anomie chez les classes moyennes et quelques autres caractéristiques comme la politique internationale de la France et de l’Europe poussent dans ce sens » (https://orientxxi.info/magazine/le-debat-censure,4262).
Pour connaisseurs Aucune illustration