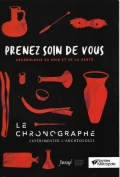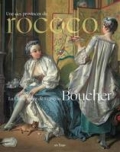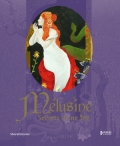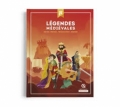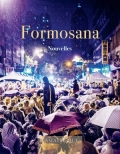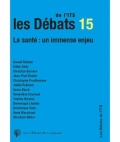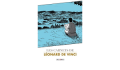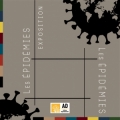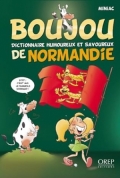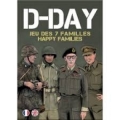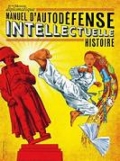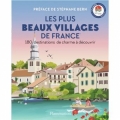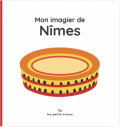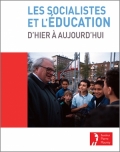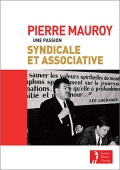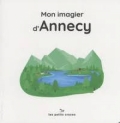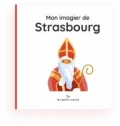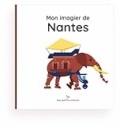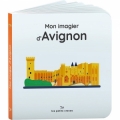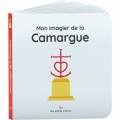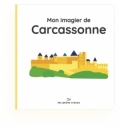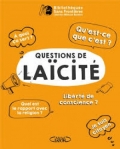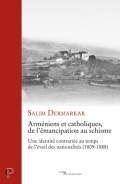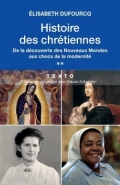Avis de Benjamin : "La loi de 1905 dans une large perspective historique"
La présentation des textes est faite par Dominique de Villepin, celui-ci étant ministre de l’Intérieur, en l’année 2004 de la sortie de l’ouvrage (il sera premier ministre de 2005 à 2007). Ce dernier écrit : « L’État royal tirait sa puissance de son dialogue direct avec le Dieu catholique. L’État laïque puise sa légitimité dans sa capacité à défendre en toute neutralité l’intérêt général. En ce sens, la laïcité n’est pas seulement un moyen d’assurer la paix entre le gouvernement et les cultes. Elle est un projet radicalement moderne qui forge un équilibre nouveau entre le respect des consciences et l’autorité de l’État » (page 8).
Jean-Michel Gaillard, un haut fonctionnaire et historien qui fut président directeur général d'Antenne 2 de 1989 à 1991, assure une introduction intitulée "L’invention de la laïcité (1598-1905)". Rappelons que 1598 fut l’année de la signature de l’édit de Nantes qui accorde la liberté de religion pour deux cultes. L’auteur précise que l’Église catholique a dénoncé, durant toute la période allant de 1790 à 1905, la liberté de conscience. Il revient sur la lutte des républicains contre les congrégations et le développement de la scolarisation. Après avoir explicité les raisons qui mettent de grande actualité la Séparation des Églises et de l’État, l’auteur revient sur les débats qui accompagne celle-ci et le refus, sur l’ordre de Pie X, de son acceptation par les catholiques français. Il a précisé au passage que le texte est voté à l’Assemblée nationale par 341 voix contre 233 et au Sénat avec 181 pour contre 102 non.
Les textes autour de la question de la laïcité sont divisés en six parties divisés par le critère de la chronologie : Liberté et laïcité (pour 1789 à 1894), La République en marche vers la Séparation (de 1900 à 1904), Et la Séparation fut décidée (période de 1904 à début 1905), La discussion générale générale à la Chambre (en partant mars 1905 pour aller à début 1905), Débat sur les modalités de la Séparation (du 10 avril au 6 décembre 1905), De la guerre des deux France à l’équilibre républicain (temps allant de janvier 1906 à janvier 1924). En annexe est proposé le texte de la loi de Séparation votée en 1905 avec de plus les modifications apportées en 1908.
On compte globalement environ cent-cinquante textes autour de moments clés. Ceux-ci sont très variés et balaient tant les textes phares (comme la Constitution civile du clergé que le Concordat) que des épisodes illustrant des évolutions dans les mentalités (tels la dénonciation des erreurs du monde moderne par Pie IX en 1864 ou deux interventions de Clemenceau l’une de 1904 où il exprime ses craintes face à une omnipotence de l’État laïque et l’autre en 1905 prédisant que le texte de la Séparation allait livrer les catholiques français à la pleine autorité du pape.
On pourra relever ces quelques passages :
« Au lendemain de la révolution de juillet 1830, qui a renversé le roi légitime Charles X et a fait de Louis-Philippe d’Orléans le « roi des Français », une nouvelle classe politique s’installe au pouvoir en France, beaucoup moins favorable à l’Église. Les catholiques libéraux considèrent alors que le Concordat de 1801 doit être dénoncé. L’abbé de Lamennais et ses collaborateurs, Henri Lacordaire – le futur restaurateur de l’ordre dominicain en France – et le jeune Charles de Montalembert – futur pair de France et académicien –, ne représentent qu’une minorité au sein du catholicisme et seront bientôt désavoués par la hiérarchie de l’Église, qui reste attachée au Concordat, nonobstant l’avènement de gouvernants anticléricaux. Mais les catholiques libéraux expriment alors leurs idées avec talent dans un journal qui a un grand impact et qui a nom L’Avenir.
" Nous demandons premièrement la liberté de conscience ou la liberté de religion, pleine, universelle, sans distinction comme sans privilège ; et par conséquent, en ce qui nous touche, nous catholiques, la totale séparation de l’Église et de l’État (…). Cette séparation nécessaire, et sans laquelle il n’existerait pour les catholiques nulle liberté religieuse, implique, d’une part, la suppression du budget ecclésiastique, et nous l’avons hautement reconnu ; d’une autre part, l’indépendance absolue du clergé dans l’ordre spirituel : le prêtre restant d’ailleurs soumis aux lois du pays, comme les autres citoyens et dans la même mesure". » (pages 53-54).
« La loi de 1901 sur les associations est une étape cruciale de la lutte contre l’influence cléricale et les congrégations religieuses. Le texte voté le 3 juillet 1901 est pour l’essentiel l’œuvre du président du Conseil René Waldeck-Rousseau (1846-1904). Député de Rennes dès 1879, ministre de l’Intérieur de 1881 à 1885, sénateur de la Loire en 1894, il est appelé à diriger le gouvernement dans la tourmente de l’affaire Dreyfus en 1899. Pour faire face aux nationalistes hostiles au régime, il forme un gouvernement de « défense républicaine » qui dure trois ans – le plus long de la IIIe République – et dans lequel il est ministre de l’Intérieur et des Cultes. Il n’est pas favorable à la séparation des Églises et de l’État, car il voit dans le Concordat un moyen de contrôler le clergé séculier. Mais pour mieux établir l’autorité de l’État sur le clergé régulier, il consacre une partie entière de la loi sur les associations aux congrégations, les obligeant à demander au gouvernement une autorisation dans un délai de trois mois. Dans ce discours prononcé à Toulouse le 28 octobre 1900, Waldeck-Rousseau définit le projet qui sera discuté au Parlement quelques mois plus tard. » (page 77)
« À la différence du prêtre catholique, qui ne monte en chaire que pour jeter l’anathème à ceux qui pensent autrement que lui, nous n’ouvrons la bouche que pour réclamer, en faveur de tout le monde, la libre recherche et le libre examen. (Applaudissements.)
Ce n’est pas à la religion que nous nous attaquons, c’est à ses ministres, qui veulent s’en faire un instrument de domination. (Bravos.) La religion, en tant que sentiment inné du cœur de l’homme, échappe à notre prise, comme les autres sentiments. En tant que système de croyances, elle a droit à la liberté, qu’aucun de nous ne songe à lui dénier. Son domaine est la conscience. Nous serions les premiers à le défendre, si, par un acte législatif ou par une mesure administrative, quelqu’un faisait mine de vouloir s’y introduire de force et s’y comporter en maître. » (Extrait d’un discours de Combes pages 113-114)
« Un inventaire est, on le sait, une opération qui a pour but de constater la présence des divers éléments d’une masse de biens, d’en faire la description par écrit, et l’estimation. Il y a un intérêt évident à procéder à cette opération chaque fois que se produit un changement dans la possession ou l’administration d’un patrimoine. C’est dans des cas de ce genre que la confection d’un inventaire est prescrite par diverses dispositions du Code civil et du Code de commerce. L’établissement d’inventaires est d’une utilité toute particulière quand il s’agit, non pas de faire passer en d’autres mains des propriétés privées, mais de liquider le vaste patrimoine de nombreux établissements publics et d’en transmettre la plus grande partie à des associations privées, indépendantes de l’État, émancipées de toute tutelle administrative. Nous nous sommes déjà longuement exprimés au sujet des caractères des biens ayant appartenu aux établissements publics des cultes, biens de fondation et biens affectés à un but d’intérêt général, avons-nous dit ; nous avons exposé dans quelles conditions la Nation, prenant possession de ces biens à l’instant de la disparition des établissements publics des cultes, se refuse à les considérer comme des biens vacants et à les confisquer, mais les transmet à ce même instant à des associations chargées de maintenir leur affectation, et respecte ainsi, tout à la fois, les intentions des fondateurs et les intérêts moraux des collectivités auxquelles ces biens sont destinés ». (pages 375-376)
Pour connaisseurs Aucune illustration










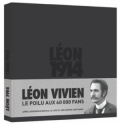
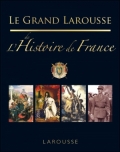
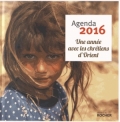
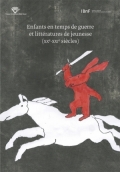
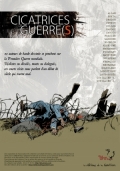
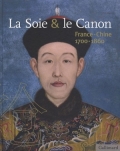
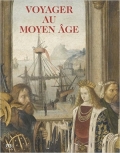
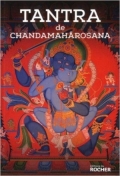
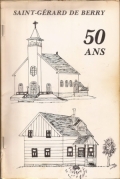
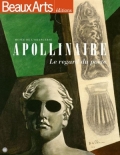
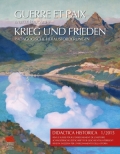




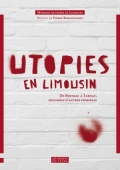
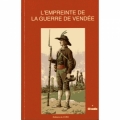
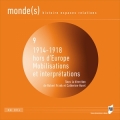
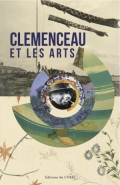
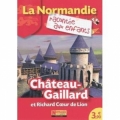
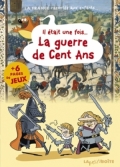
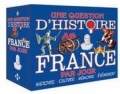

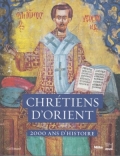
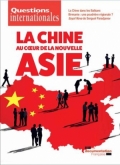
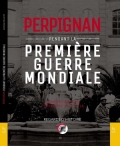
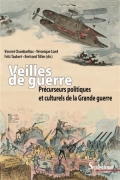


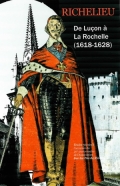



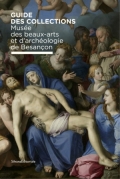
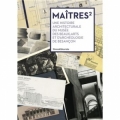
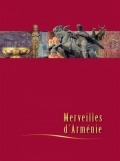

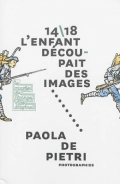

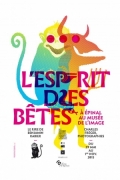

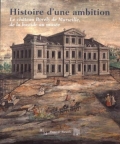

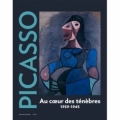
![Hors cadre[s], n°25 Hors cadre[s], n°25](/img/livre/collectif-hors-cadre-s-n-25_thumb.jpg)