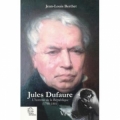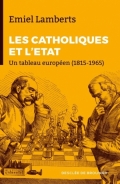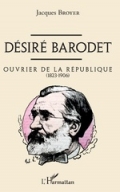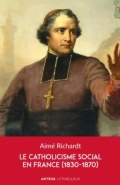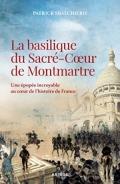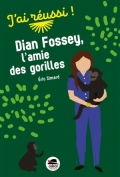Avis de Benjamin : "Aller à rebours des processus de sécularisation et retrouver un régime monarchique"
La période de l’Ordre Moral dure de 1873 à 1877. Elle est restée un moment iconique de résistance au pouvoir dans la mémoire de l’ensemble de la gauche française. En tant qu’invective, elle a été adressée aux partisans de la Manif pour tous. Elle a été évoquée récemment quelque peu dans les médias, par ceux qui entendaient destituer Emmanuel Macron de son mandat de président, dans la mesure où elle est un des deux cas de l’Histoire française débouchant sur une démission forcée d’un président de la République. À la suite d'un nouveau revers des monarchistes aux sénatoriales de 1879, le général Mac-Mahon, se retrouvant avec les deux chambres hostiles, décide de démissionner. En 1924, le président Alexandre Millerand fut également mis dans l’obligation de se démettre, cette fois par la victoire du Cartel des gauches.
Le sous-titre de ce livre est Royalisme, catholicisme et conservatisme. Dans le tout début de l’introduction sont cités les propos de Mac Mahon le lendemain de son élection comme président de la République française. Ceux-ci sont : « Avec l’aide de Dieu, le dévouement de notre armée […], l’appui de tous les honnêtes gens, nous continuerons l’œuvre de libération de notre territoire et du rétablissement de l’Ordre Moral dans notre pays » (page 7).
Cette période de tensions politiques extrêmes, de mysticisme religieux et d’espoir de retour à la monarchie ont été peu étudiées par des universitaires. Il y a eu une volonté d’une rare intensité de conquête de l’opinion par des milieux contre-révolutionnaires dans un moment d’indétermination politique. Cette tentative va souder contre elle anciens partisans de la Commune et une partie de ses adversaires. Cet arc républicain va de Raspail jusqu’à Thiers (mort le 3 septembre 1877 en pleine campagne électorale, pour un premier tour prévu le 14 octobre). Mme Thiers n’accepte d’ailleurs pas les funérailles officielles car il lui est refusé que le cortège soit suivi par les 363 députés qui ont refusé l’investiture à Broglie le 17 mai 1877.
La première partie s’intitule d’ailleurs "Entre monarchie et république". Dans cette introduction, les deux directeurs de l’ouvrage présentent les contributions de celle-ci. « Les différents combinaisons gouvernementales de l’Ordre Moral ont été passées en revue à partir des ministres ( Éric Anseau ) ainsi que les préfets qui ont été les rouages sur le territoire national ( François-Xavier Martishang). Deux familles politiques, le bonapartisme (Jean-Paul Pellegrinetti) et le légitimisme (Alexandre Dupont), ont fait l’objet d’un regard neuf. Novatrice est également l’approche qui a dévoilé des influences féminines au sein des réseaux royalistes avec la maréchale de Mac-Mahon (Mattieu Brejon de Lavergnée) et la duchesse de Galliera (Grégoire Franconie). L’affaire du "drapeau blanc" nécessitait un incontournable rappel (Jules Grévy) tandis qu’une plogée dans la France royaliste prenait la mesure de l’impossible reconquête (Éric Derenne). »
"Sauvez Rome et la France au nom du Sacré-Cœur" est le titre du second volet. « Rome s’est montré à la fois surpris et perplexe (Arthur Hérisson), le corps des évêques et des vicaires généraux plutôt réservé (Jacques-Olivier Boudon), celui des ordres et des congrégations tout aussi hésitant (Christian Sorrel). Sur le terrain, les enterrements civils sont bannis et la "bonne mort" chrétienne exaltée (Guillaume Cuchet), les apparitions mariales redoublent d’intensité et de signification (Philippe Boutry), les pèlerinages donnent à voir la "conversion nationale". L’arsenal législatif offre de nouvelles possibilités de reconquête : dans l’armée avec l’institution d’une aumônerie militaire (Xavier Boniface), dans l’enseignement supérieur avec la création des facultés catholiques, de droit notamment (Myriam Biscay) et dans l’ordinaire de la vie avec entre autres l’instauration du repos du dimanche et l’érection de Montmartre (Daniel Moulinet). » On voit que, parmi cet inventaire, certaines dimensions sociétales ou monumentales ont perduré.
Par haine des prétendants orléanistes, les légitimistes firent échouer la candidature du duc d’Aumale (député de l’Oise de 1871 à 1876) à la présidence de la République et ils se rallièrent à Mac-Mahon. Est très significative l’incompréhension rapportée entre le général du Barail alors ministre de la Guerre et de Broglie président du Conseil. « Toute la difficulté de la majorité de l’Ordre Moral est dans ce vif échange entre un orléaniste, modéré et parlementaire dans l’âme et un général qui plus est de sensibilité bonapartiste et très antiparlementaire ! » (page 25). Éric Anceau en conclut, qu’au sein des gouvernements de Broglie et Ernest Courtot de Cissey, il y a incompatibilité entre des orléanistes à la tradition parlementaire et des bonapartistes antiparlementaires.
Il y a aussi de grandes frictions entre orléanistes opposés aux manifestations cléricales, hostiles au mouvement carliste espagnol mais aussi désirant renouer des relations avec le roi d’Italie et les légitimistes sur des positions diamétralement opposées (allant jusqu’à souhaiter que le pape retrouve la jouissance de ses États, au besoin avec le soutien de l’armée française). D’ailleurs bonapartistes et légitimistes s’allient aux républicains pour faire tomber le ministère de Broglie le 16 mai 1874 et pour faire élire des sénateurs inamovibles républicains un peu plus tard.
Nous préciserons personnellement qu’à l’Ouest, les circonscriptions (de Vendée, des Deux-Sèvres, de Maine-et-Loire et de Loire-Atlantique), qui furent touchées par le soulèvement vendéen, élisent des royalistes légitimistes en 1875 et 1877. Ceci explique par exemple pourquoi les deux circonscriptions de l’arrondissement de Fontenay-le-Comte (n’appartenant pas à la Vendée militaire) votent pour un républicain, l’un Beaussire parmi les républicains les plus modérés depuis 1871 comme Léon Say, et l’autre Bienvenu proche de Jules Ferry. Éric Derenne choisit de s’attarder un peu sur la situation dans le Gard où la mairie de Nîmes est aux mains du légitimiste Adolphe Blanchard.
La conservation de l’ordre social n’est pas le seul objectif des légitimistes, il y a aussi évidemment le désir d’amener le règne d’Henri V (le comte de Chambord) dans le cadre d’une monarchie traditionnelle mais aussi restaurer les valeurs familiales et promouvoir le catholicisme donc revenir sur certains dispositions laïques. Les légitimistes n’ont pas de chef en France, c’est une collection d’individualités. Leur postulant au trône est un prétendant qui pose des conditions précises non négociables. En septembre 1873, ce dernier déclarait : « je ne suis pas candidat à la royauté par principe de gouvernement […]. [Si] on ne veut qu’une monarchie de circonstance, destinée à légaliser les courants révolutionnaires […] il est inutile de m’appeler. » Les succès électoraux des bonapartistes en 1874 amènent orléanistes et républicains à se rapprocher. « Cette alliance politique est à l’origine, le 30 janvier 1875, du vote de l’amendement d’Henri Wallon, introduisant le mot République dans la Constitution française » (page 61).
Mgr Dupanloup, évêque d’Orléans de 1849 à a mort en 1878, député puis sénateur inamovible, a l’oreille de Mac Mahon pour les nominations de nouveaux évêques et le nonce est parfois mis devant le fait accompli. Le père d’Alzon, déjà vicaire général sous Mgr Claude-Henri Plantier, reste en place avec Mgr Besson évêque de Nîmes. Légitimiste par tradition, il entend faire passer d’abord les intérêts de l’Église. Ceci explique qu’il ait pu déclarer : « bon nombre de légitimistes préféreront la République honnête à la monarchie batarde ».
Les enterrements civils ayant le risque, aux yeux des autorités, de passer pour une manifestation politique sont réglementés jusqu’à leur donner des conditions très brimantes. Cependant réprimer une incroyance en l’empêchant de s’afficher est une idée présente chez certains qui perçoivent l’athéisme comme antisocial. Pour les âmes pieuses, la défaite lors de la Guerre franco-prussienne avait été un châtiment de Dieu et il fallait expier les crimes de la Commune. Les pèlerinages sont nombreux et les foules abondantes pendant la période de l’Ordre Moral, un discours politique y est servi dans certains d’entre eux. Paray-le-Monial est un centre de dévotion au Sacré-Cœur porteur de l’idée d’un cœur charnel ainsi qu’ardent, La Salette est vouée à la Vierge menaçanre donc une divinité irritée alors que Lourdes porte l’idée de Vierge secourable qui est une divinité aimante et secourable. Des écrits eschatologiques dus à des prêtres fleurissent comme ceux de l’abbé Chabauty, curé à Saint-André de Mirebeau (au nord-ouest de Poitiers).
En 1872, l’évêque de Laval reconnaît l’apparition de l’année précédente à Pontmain ; d’autres apparitions sont médiatisées mais aucune ne recevra d’approbation papale. La principale est celle de Saint-Bauzille-de-la-Sylve (à l’ouest de Montpellier) ; les apparitions mariales se sont déroulées d'après les affirmations d’Auguste Arnaud le 8 juin 1873 et le 8 juillet 1873. Il y a aussi des apparitions rapportées à Veyziat près d’Oyonnax. En Alsace et Lorraine récemment annexées en 1872, on évoque également des apparitions mariales avec parfois un contenu pro-français. Notamment aux Batignolles, à Semois-sur-Seine, à Saint-Jean-de-Maurienne, à Pellevoisin (dans l’Indre), d’autres apparitions avec bien entendu des messages sont censées se produire. La liste n’est pas close pour autant. Mgr Dupanloup appelle à la raison, allant jusqu’à déclarer en juillet 1872 que les prophéties rapportées par ces apparitions relèvent de l’imagination.
Il est bon de rappeler que petits séminaires, en nombre réduits n’étaient, jusqu’à la Monarchie de juillet et depuis la tourment révolutionnaire, que le seul lieu où pouvaient enseigner des clercs. « Après avoir obtenu la liberté de l’enseignement primaire par la loi Guizot en 1833, puis secondaire avec le loi Falloux de 1850 ; la loi du 12 juillet 1875 la liberté de l’enseignement supérieur vient couronner ce processus » (page 270). En perspective de cette loi, les cours de droit avaient déjà débuté à la rentrée universitaire de 1874 pour l’université catholique de Lille en voie de reconnaissance officielle. Lyon, Angers et Paris auront également une université catholique. Un portrait est dressé ici de nombreux premiers enseignants recrutés. Les légitimistes sont majoritaires parmi ce personnel. Dans un premier temps ne sont enseignés que le droit canon, le droit civil et les sciences politiques. Les professeurs dispensent des conférences ouvertes au public (masculin ou féminin), là comme dans leurs cours ils ne se privent pas de critiquer certains aspects de la législation républicaine de l’époque.
Mises à part cette loi de liberté de l’enseignement supérieur (12 juillet 1875), d’autres mesures législatives visant à renforcer l’influence catholique sont votées. L’une déclare d’utilité publique la construction d’un sanctuaire consacré au Sacré-Cœur (24 juillet 1873), une autre organisant le service religieux dans l’armée et débouchant sur l’augmentation importante du nombre d’aumôniers militaires des cultes reconnus (3 juin 1874). Une proposition de loi autour du repos dominical, visant à renforcer les dispositions de la loi du 18 novembre 1814 est déposée mais repoussée par quarante-et-une voix en juin 1874.
Nous n’avons mis en exergue que quelques faits du contenu proposé dans L’Ordre moral 1873-1877. Cet ouvrage permet d’avoir une vue fine de l’univers politique et religieux de la période de l’Ordre Moral. Il offre un index avec les noms de personnes, de lieux, d’associations ou de congrégations citées. Les références sont très nombreuses, les Belfortains pourront ainsi voir que leur député catholique Émile Keller est présent à huit occasions différentes et ceux qui s’intéressent au pèlerinage de Paray-le-Monial trouveront dix-neuf pages (de la 13 à la 386) où il est question de ce phénomène.
Pour connaisseurs Aucune illustration