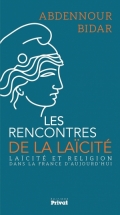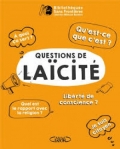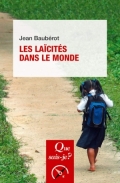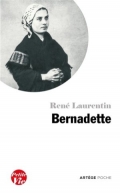Avis de Benjamin : "La laïcité n’est pas la neutralité"
La notion de laïcité est définie à travers cinquante points regroupés en six thèmes. Ces dernier sont respectivement : Le mot et l’idée, Un principe juridique et politique, Les contraintes de la laïcité, En France et ailleurs, Préhistoire et histoire de la laïcité, Cas épineux et problèmes du quotidien.
Chaque question est traitée entre trois et quatre pages ; elle est non seulement, dans un premier temps, l’objet d’un exposé mais également, dans un second mouvement, elle est problématisée. Ceci amène à des précisions utiles comme celle-ci : « Le loi de 2010 n’a rien à voir avec la laïcité mise en place par la loi du 9 décembre 1905. Elle est une loi de sécurité publique et de protection de la femme : il faut pouvoir être identifiée dans la rue ; il faut défendre les femmes contre un traitement dégradant qui porterait atteinte à leur dignité en les empêchant qui porterait atteinte à leur dignité en les empêchant de vivre en tant qu’actrices sociales » (page 23).
Dans le même point "Distinguer privé et public (deux sphères et trois espaces)", on distingue pertinemment la sphère publique (propre à la loi commune) et la sphère privée (régie par la loi privée). On passe ensuite aux espaces, le premier privé, le second public (les lieux partagés comme une rue), le troisième étant l’espace politique (appartenant à l’espace public mais se distinguant dans cet ensemble par le fait que la puissance publique s’y exerce, donc les lois en rapport avec la laïcité). Plus loin, il y a distinction entre sphère privée (ouvert à la présence de diverses personnes) et l’intime (on peut s’y soustraire au regard des autres).
Parmi les questions relevant du premier ensemble, il y a aussi notamment "Laïcité et neutralité". Dans le second chapitre, on relève particulièrement "La laïcité à l’école : la loi du 15 mars 2014". Le troisième volet propose, parmi cinq questions, celle intitulée "La laïcité n’est pas l’athéisme". La quatrième partie examine, parmi un ensemble de pays, les situations originales du point de vue laïque, aux États-Unis, au Canada anglophone et au Québec. Le cinquième chapitre s’intéresse aux dimensions historiques, se centrant singulièrement sur "La séparation du temporel et du spirituel dans les trois monothéismes". La dernière partie permet d’exposer des questions qui ont fait l’actualité "Les élus ont-ils l’obligation d’observer la neutralité confessionnelle".
Comme citation, on peut retenir : « Dans l’histoire de la construction républicaine et selon ses pères fondateurs, la laïcité n’est pas neutre. Pour nombre de ses promoteurs, elle est porteuse d’une philosophie politique, d’un projet humaniste, d’une forte exigence morale, d’une éthique rationaliste. Ceux qui accomplirent la laïcité étaient animés par un élan de liberté et un idéal de rationalité, dans le sillage des Lumières. Un État laïque est un État républicain ordonné en vue de l’intérêt général. Ce n’est pas la neutralité qu’ils mirent en avant, mais le bien commun, la participation démocratique et une raison libérée du joug des dogmatiques religieux » (page 26).
La laïcité garantit la liberté et l'égalité de tous et elle engendre toutes sortes de réponses face à des situations contemporaines complexes. L’auteure Irène Debost Bachler, professeure de philosophie en lycée et enseignante dans un centre de formation des maîtres, livre là un discours tant exhaustif que compréhensif abordant des dimensions juridiques, politiques, historiques et géographiques.
Pour tous publics Aucune illustration