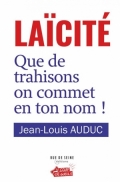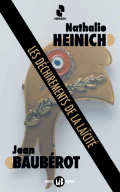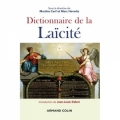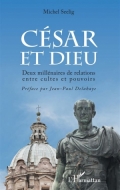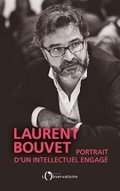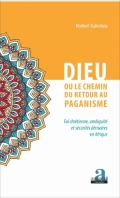Avis de Benjamin : "Des entrepreneurs de la cause laïque aux récepteurs de l’idée de la laïcité"
L’ouvrage, fruit d’un colloque organisé à l’Université de Bordeaux, propose une introduction cosignée par les trois personnes qui ont dirigé ce titre. Dans cette partie, les auteurs renvoient de manière assez concise sur le contenu des contributions qui suivent. Ils rappellent que l’avis du 27 novembre 1989 du Conseil d’État qui déclare le port d’insignes religieux par les élèves comme non incompatible avec le principe de laïcité mais que le prosélytisme (sous diverses formes) par contre leur est interdit. La Ligue de l’enseignement, en soutenant cette position, se voit accusée de trahison par certains laïques.
Le contenu du Rapport Baroin est rappelé, il voit ainsi une partie de la droite s’emparer, avec une certaine lecture, de l’idée laïque. En prolongement est créée la Commission Stasi qui pose en 2004 des critères de visibilité du religieux dans l’espace public. À partir du moment où la laïcité n’est plus un enjeu face au catholicisme mais le devient au regard de l’islam, les socialistes français se divisent en trois opinions sur le sujet. « La première regroupe les partisans d’une laïcité stricte, soit pour des raisons antireligieuses (Jean Glavany), soit pour des raisons identitaires (Manel Valls). Ils souhaitent ne pas laisser à la droite le monopole de la "nouvelle laïcité" d’interdiction. La deuxième tendance fédère ceux qui dénoncent l’instrumentalisation de la laïcité contre la "nouvelle laïcité" au nom des libertés, et du rapport à la diversité. La troisième demeure dans une forme d’ambiguïté, et de neutralité, par peur des conséquences électorales d’un positionnement trop explicite » (page 11).
Il est aussi pointé qu’à partir de 2007, le Front national défend « "une laïcité" chargée de l’assimilation des étrangers et de la préservation de l’identité chrétienne de la France. Mais les exigences de cette assimilation sont tellement hautes qu’elles sont quasiment inaccessibles, et donc excluantes. La laïcité est une sorte de code qui permet au Front national, désormais Rassemblement national (RN), de mobiliser une sémantique républicaine dénuée de toute référence raciale, tout en poursuivant son projet original » (page 12).
Il est également question de réfléchir autour de l’investissement du concept de laïcité dans l’univers catholique au milieu des années 2010. « Deux stratégies s’opposent ici. Premièrement, celle de la Conférence des évêques de France, qui promeut une " laïcité ouverte" qui, implicitement, garantit à l’Église catholique une forme de prééminence sur les autres religions ainsi qu’un rôle central dans la gestion de la diversité convictionnelle. Deuxièmement, celle des catholiques conservateurs, qui veulent faire de la laïcité un héritage du christianisme, incompatible avec les conceptions politiques de l’islam. Selon ces derniers, l’État doit constitutionnaliser l’identité chrétienne de la France pour donner une assise solide au principe de laïcité » (page 12).
Trois contributions s’intéressent particulièrement au vocabulaire et aux représentations de la laïcité dans les médias, chez des élèves de cours moyen, et des électeurs à la présidentielle de 2017. On relève que l’univers conceptuel de la laïcité renvoie à des expériences concrètes, au rapport avec l’univers religieux, aux engagements politiques ou syndicaux et aux conditions sociales. On renvoie ici au texte de Cécile Alduy (petite-fille de Paul Alduy) qui écrit page 149 que « la laïcité a beau être une valeur consensuelle pour une grande majorité de Français, elle reste propice aux interprétations divergentes. Lue à travers le prisme d’obsessions et de valeurs disparates, elle est définie par certains comme un idéal de respect et d’harmonie mais aussi utilisée comme fer de lance d’une contribution identitaire ». Pour elle, le concept de laïcité garde une conception universaliste et pluraliste, qui montre la « résilience d’une valeur profondément ouverte, humaniste et républicaine » (page 150).
On a donc six contributions suivant l’introduction. Ces textes sont sont des approches de la manière dont certains « “entrepreneurs de cause” […] s’emploient volontairement à (re)définir la laïcité en fonction de leur projet idéologique ou électoral », alors que d’autres « “récepteurs”, c’est-à-dire ceux qui, tout en maniant le mot, n’ont pas d’agenda spécifique à promouvoir, se réapproprient et mobilisent ces nouveaux vocabulaires de la laïcité » (page 10).
Ceux-ci sont respectivement intitulées: La laïcité au Parti socialiste: De l’emblême au problème (signature de Rémi Lefebvre), Le Rassemblement national et la laïcité: Retour sur des usages contradictoires (de Sylvain Crépon), L’Église, fille aînée de la République? Les apologies de la catho-laïcité depuis les attentats de janvier 2015 (texte d’Yann Raison du Cleuziou), Laïcité (France) vs accomodements raisonnables (Québec): Circulation transnationale des discours publipublics sur la définition des rapports au religieux (coécriture par Valérie Amirux et David Koussens), Le vocabulaire enfantin de la laïcité: Une enquête auprès d’écoliers bordelais (contribution de Charles Mercier), Ce que disent les Français de la laïcité: Consensus et polémiques identitaires (de la part de Cécile Alduy).
Pour connaisseurs Aucune illustration