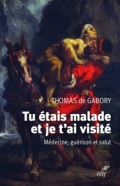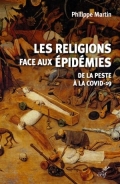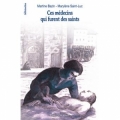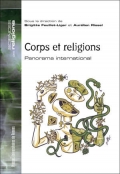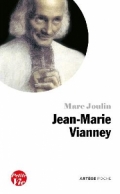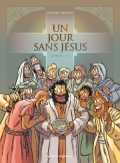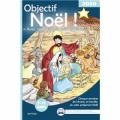Avis de Benjamin : "L'Église est menacée de devenir une sous-culture (Mgr Albert Rouet)"
Christian Delahaye a été journaliste dans la presse médicale, il possède un master en dialogue interreligieux. Il mène toujours des recherches et enquêtes théologiques en publiant des essais et des articles sur la crise du christianisme. Il est aujourd’hui versé dans l’agriculture biologique dans l’Orne. L’ouvrage est sous-titré Fondements historiques, enjeux interreligieux et défis théologiques de la nouvelle laïcité à l'hôpital parcours à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Dans son premier chapitre, l’auteur évoque la prise en charge totale de l’hôpital par les congrégations jusqu’en 1789. Relevons au passage la création en 1633 de la Compagnie des Filles de la Charité par Saint Vincent de Paul. Cependant d’autres sources que celles provenant de Christian Delahaye, nous ont personnellement informés que les conseils d’administration de ces institutions hospitalières comptent une majorité de notables locaux. Les établissements sont laïcisés par la Révolution française, mais toutefois les religieuses font leur retour en 1805 avec le rétablissement des congrégations. La laïcisation du personnel et des lieux (enlèvement des crucifix dans les salles et sur les corbillards) se fait progressivement dans les débuts de la IIIe République.
Cependant la loi de 1905 institue des aumôniers salariés dans les hôpitaux, appartenant aux cultes reconnus de l’époque. Celles-ci se diversifient, avec notamment la création en 2005 la création de l’aumônerie musulmane et en 2013 celle des bouddhistes (les Témoins de Jéhovah depuis 2014, année de sortie de ce livre ; ceci expliquant l’absence de mention). Ces aumôniers sont fortement encouragés à suivre des diplômes d’université les préparant à mieux exercer leurs fonctions en respectant la laïcité. L’existence possible d’une seule salle commune à tous les cultes religieux entraîne des réticences, venues la plupart du temps de certains évêques catholiques.
Le dernier chapitre de l’ouvrage est intitulé "La Théologie du dialogue en contexte hospitalier". Depuis Vatican II, l’Église catholique est invitée au dialogue avec la société civile donc le monde profane et au dialogue interreligieux. Ceci a diverses conséquences dans l’univers hospitalier. Pour Christian Delahaye, il y a une exacerbation du spirituel chez la personne hospitalisée. En avance de dix ans sur les écrits d’Arkadiusz Kozelak-Maréchal dans Religion, spiritualité, laïcité et soin, il émet ce qui reste toutefois une opinion personnelle : « Par la prise en compte de la détresse spirituelle, les membres des équipes d’aumônerie sont dès lors admis à intervenir dans la prise en charge pluridisciplinaire du patient ; leur participation aux staffs et autres réunions de services peut être légitimée, fournissant un nouvel argument au dialogue engagé avec les professionnels de santé. Le croire et le soin ne sont plus des exoplanètes, mais s’orbitent mutuellement autour de l’un l’autre » (page 149). Il propose de s’appuyer sur l’encyclique Ecclesia suam rédigée par Paul VI pour que l’Église fasse de l’hôpital un lieu de conversation qui peut pourrait même devenir un espace de conversion, vu la vie que le patient a eu dans l’univers sécularisé de la société actuelle.
Dans cet esprit, Christian Delahaye déclare : « Si la mort, en fin de compte, ne peut être que différée par les soignants, le dialogue du salut pourra proposer l’accueil d’un mourir qui n’est pas appréhender comme la fin d’un tout. Un mourir qui fait partie de la vie. (…) À la suite du Christ mourant, le patient est invité par l’aumônier à rencontrer l’amour du Père, dans un mourir où il découvre qu’il n’est pas anéanti. (…) Au cœur de l’univers technicisé de l’hôpital, dans la confrontation à la multiculturalité, face à la personne qui a "recomposé" le spirituel en sa conscience personnelle, qui fait l’expérience de la souffrance et y risque jusqu‘à ses repères vitaux, le dialogue de salut vise à découvrir le chemin de mort et de résurrection ouvert sur la Croix, en proposant au patient la relation avec Jésus, avec celui qui se laisse toucher par lui, et pas seulement de compassion » (pages 162-163). En toute logique du contenu, mais peut-être pas en harmonie avec le titre de l’ouvrage "La laïcité à l’hôpital", la conclusion porte pour titre "La mission d’évangélisation à l’hôpital".
Pour tous publics Aucune illustration