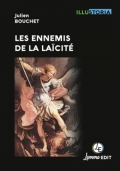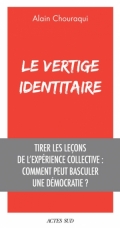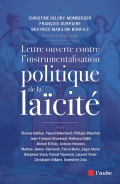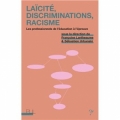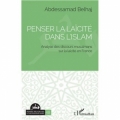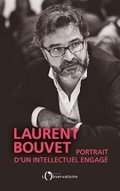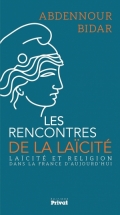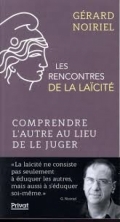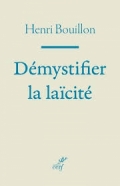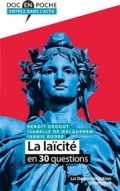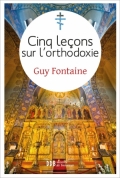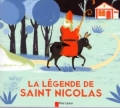Avis de Benjamin : "La laïcité peut-elle servir à mieux accepter l’altérite ?"
L’auteur est un universitaire, sociologue et politologue français. Il a longtemps enseigné à l’université de Limoges, où d’ailleurs a été soutenu une thèse Ordre public et laïcité qui a donné lieu à une publication éponyme. Il a été également rédacteur en chef de la revue Les Cahiers rationalistes. En avril 2023, Pap Ndiaye le ministre de l'Éducation nationale le nomme au Conseil des Sages de la laïcité. Nicole Belloubet, au même ministère pendant une partie de l’année 2024, le démet de ces fonctions le 24 avril 2024.
Ceci répond à une campagne de presse de certains médias qui mettaient en cause les positions d’ Alain Policar en matière de racialisme, antiracisme et laïcité. Cela se fait après qu’il ait déclaré sur RFI le 5 avril que « Le voile n’est pas le plus souvent un signe de prosélytisme – les enquêtes sociologiques montrent qu’il s’agit même souvent d’un vecteur d’émancipation pour les jeunes filles par rapport à leurs milieux – et le port du voile devrait donc être analysé chaque fois au cas par cas ». Il ajoutait, à propos des difficultés d’appliquer sereinement la loi de 2004, que la cause en était qu’elle était perçue, par nombre de musulmans comme discriminatoire à leur égard, ceci à tort ou à raison.
Dans l’introduction, note auteur rappelle ces derniers faits, mais précise que cet ouvrage n’est pas un livre lié directement à ces circonstances. Pour lui, la loi du 15 mars 2004 a renforcé le communautarisme en donnant une image de la laïcité fondée sur des interdits plus que sur la liberté. Il poursuit en qualifiant de sécuritaire la laïcité portée par le Rassemblement national. Pour ce dernier « l’étranger est supposé dénaturer nos paysages familiers, transformer nos mœurs ; bref, remettre en cause notre homogénéité fantasmée » (page 13). Il poursuit par que le rejet de l’Union européenne n’est plus le seul mot d’ordre du national-populisme. « Le nativisme a pris le relais, avec son rejet des immigrés et des minorités religieuses, plus précisément l’hostilité envers l’islam » (page 15). La laïcité est donc devenue une valeur identitaire pour « essentialiser les différences collectives et les ériger en obstacles à la perception de notre destin commun » (page 15).
Le livre est composé de quatre chapitres : La laïcité ou la coexistence des libertés, Une affaire exemplaire : peut-on invisibiliser la différence ?, Figures du dévoiement, Le pluralisme en péril. Au premier chapitre, note auteur revient sur les origines de la laïcité, et il la trouve dans un esprit de tolérance porté par notamment Pierre Bayle et Voltaire mais aussi d’une figure méconnue, antérieure aux deux précédentes, à savoir Sébastien Castellion (1515-1563), né en Bugey, terre alors des ducs de Savoie. Il cite un de ses propos : « le christianisme ne saurait s’accommoder sans se trahir de la persécution des hérétiques » (page 21).
Alain Policar avance alors que « l’intolérance consiste à revendiquer une place spécifique pour mes propres valeurs ou pour mon mode de vie et, pour cette raison, à vouloir les protéger jusquà limiter, voire supprimer, d’autres valeurs que les miennes. Ce qui revient à refuser à celles et ceux qui les défendent le statut de membre à part entière de la société. À l’inverse, la tolérance consistera à insister sur notre appartenance commune à un ensemble social et à reconnaître que les autres ont tout autant que moi le droit de contribuer à définir les normes » (page 25).
L’auteur revient également sur la loi de 1905 dans ce même chapitre. « Si la laïcité exclut l’emprise du religieux sur l’espace public, elle n’est pas incompatible avec son expression, et elle le protège face à une éventuelle ingérence de l’État » (page 34). Il s’intéresse ensuite aux propose de Laurent Bouvet pour qui la laïcité n’est pas un principe mais relève de la valeur. Or pour Alain Policar, au contraire la laïcité ne relève pas de la croyance mais d'un fait. Le Printemps républicain, dynamisé par Laurent Bouvet, a porté une morale identitaire de la laïcité. Pour ce dernier, l’islam menace les valeurs républicaines et pour Pierre Manent les musulmans remettent en cause les racines chrétiennes de la France.
Le second chapitre est consacré à exposer les conséquences de l’Affaire des foulards de Creil, évènement datant de 1989. Certains pensent que manifester son appartenance religieuse revient à défier la République. En passant par les conclusions de la Commission Stasi, on arrive à la loi de 2004. L’État donne du sens aux vêtements portés, il émet un jugement sur les intentions et non plus sur les actes. Pour l’auteur « alors qu’elle devait servir à la formation de l’esprit critique et à la promotion des valeurs universelles, qu’elle participait d’une représentation libératrice du savoir, la laïcité apparaît aujourd’hui comme une réaction nostalgique d’une identité majoritaire, incapable de penser les identités minorées. Notre modèle républicain, en scotomisant les appartenances, s’interdit ainsi de comprendre la construction des subjectivités » (page 74). La laïcité est devenue une valeur identitaire pour ceux qui interprètent le sens à donner à certaines attitudes.
Le troisième chapitre évoque le fait que les lois se réclamant de la laïcité prétendent combattre le port du voile au nom de l’égalité des sexes, lutter contre l’islamisme et prévenir l’antisémitisme pour rappeler les exigences d’une intégration à la société française. Les valeurs de progrès, de solidarité, d’antiracisme se déclinent avec des mesures coercitives pouvant passer pour de la xénophobie. Selon les pays, l’islam serait rejeté comme rétrograde et homophobe (pour les Pays-Bas), incompatible avec l’héritage catholique (cas de l’Italie) et opposé aux valeurs de la laïcité (avec la France). Pour justifier une aversion envers l’islam, on instrumentaliserait le féminisme, une lutte contre le séparatisme, un combat contre l’antisémitisme (en confondant parfois antisionisme et antisémitisme).
Alain Policar revient, dans son dernier chapitre, sur les polémiques autour d’un prétendu islamogauchisme et d’un discours wokiste. Il ne nie pas l’existence du Parti des indigènes de la République, porté par notamment Houria Bouteldja, mais lui dénie toute influence en milieu universitaire. Il y aurait une fascination pour une homogénisation de la société soutenue par une islamophobie. S’appuyant sur un passage d’un écrit d’Étienne Balibar, Alain Policar appelle à un effort d’ouverture à l’altérité. Il admet les dangers portés par l’existence d’un islam rigoriste et intolérant ainsi que par l’expression d’un terrorisme islamique. L’auteur parle d’action compensatoire car être traité comme un égal n’implique pas nécessairement un traitement égal. Ceci se ferait dans une perspective de déconstruction de la hiérarchisation sociale. Il met en avant l’idée de faire vivre la laïcité, pensée contenue dans la Charte de la Laïcité à l’école de 2013.
Compte-tenu de la sécularisation imprégnant la société française, se dégage l’idée que montrer trop visiblement son appartenance religieuse peut passer pour un non-respect de la laïcité. Par ailleurs il est certain que des populations se sentant rejetées ont la tentation de repli communautaire. Les lois doivent relever de la raison publique, à savoir accessibilité, intelligibilité et partageabilité. L’égalité civique et la liberté personnelle sont d’autres principes pour un sécularisme accepté de tous. La Déclaration universelle sur la laïcité au XXIe siècle du 9 décembre 2005 fait écho aux idées de l’auteur.
De la conclusion, on retiendra spécialement : « nous devons nous prévenir contre deux impasses, celle de l’universel et celle du pluriel sans universel. Chacun doit comprendre qu’il n’est pas différent des autres mais différent conte les autres » (page 164). L’intérêt de cet ouvrage est qu’il entend exposer, dans une grande cohérence, une laïcité reconnaîssant l’utilité sociale de la religion, entendant défendre la liberté de conscience mais aussi liant combat laïque et combat social. Elle entend lutter contre le repli communautariste tout en reconnaissant que l’individu est membre d’une communauté ou de communautés plurielles. La question reste de savoir quelle proportion de la population française peut adhérer pleinement à ses objectifs et si on ne peut pas voir certains des buts exposés ici se traduire, par une dérive, vers un renforcement du communautarisme alors que l’auteur entend encadrer ce dernier.
Pour connaisseurs Aucune illustration