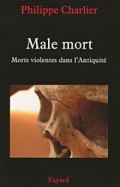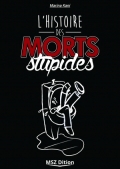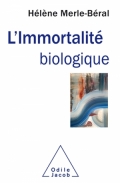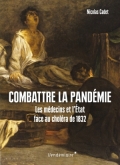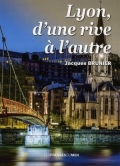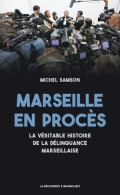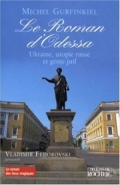Avis de Ernest : "Tout aussi inégaux face à la mort que durant la vie"
Pour des raisons techniques, nous n’avons pu mettre plus haut le sous-titre de ce livre, ce dernier est Funérailles, dénuement et précarité en Europe du XVIIIe siècle à nos jours. En novembre 2023 s’était tenu un colloque Cadavres et pauvreté dans le cadre d’un séminaire intitulé Histoire et anthropologie de la mort à Aix-en-Provence. Cet ouvrage ne propose pas toutes les contributions présentées lors de ce colloque mais en constitue un prolongement en offrant également d’autres textes sur le sujet.
Voici les auteurs des textes et le titre de ces derniers (proposés dans l’ordre chronologique de la période qu’ils évoquent après les pages de l’introduction): Elisabeth Anstett, Anne Carol Introduction Un traitement funéraire, à quel prix ?, Catherine Rigeade, Yann Ardagna, Patrick Ferreira, Christophe Ranché Disparités sociales et pratiques funéraires: L'exemple du site archéologique de la caserne Montlaur (Bonifacio, Corse du Sud), Régis Bertrand, Anne Carol Cadavres et pauvreté: Une perspective historique (France XVIIIe début XXe siècle), Diego Carnevale Des cadavres disputés: Conflits juridictionnels et pratiques sociales autour de la sépulture de pauvres à Naples sous l'Ancien Régime, Tom Riché La dégradation juridico-économique du supplicié (Toulouse, 1737-1780), Tristan Portier L'économie morale de la mort en Grande-Bretagne: Principes, crises, disparition, Roxanne Bonnardel Mira « How the poor die »: Identifications et trajectoires posthumes des cadavres étrangers à Paris (fin du XIXe siècle-début XXe siècle), Cristina Ciancio Les cadavres des pauvres, ressources pour la science: Une affaire judiciaire dans l'Italie du début du XXe siècle, Andrea Benedetti La prise en charge de la dépouille de Jakov Tcherniak par l'Internationale ouvrière Entre disputes et solidarités (1907), Jordi Moreras L'évolution des parcours funéraires et la question du rapatriement des dépouille: Le cas des Marocains décédés en Catalogne (1968-2000), Neus Javega De la mort solitaire à la mort solidaire: Funérailles et solidarités financières chez les Marocains de la province de Tarragone (Espagne), Lisa Carayon Un droit funéraire de la pauvreté: Regard critique sur un dispositif de marginalisation des corps, Yann Benoist Des morts oubliés de (presque) tous. La place de l'État et des associations dans les funérailles des morts de la rue.
Ces recherches sur la mort et les morts relèvent du champ des sciences humaines et sociales, mais on devine rien qu’à leur titre quelles peuvent être aussi bien du domaine de l’anthropologie, que de l’archéologie, des sciences politiques, du droit, de l’histoire, de la sociologie ou de l’urbanisme. Ici le questionnement principal est : « Qui sont ceux pour qui les funérailles sont prises en charge par des mécanismes de solidarité ou de charité ? Cette prise en charge par des mécanismes de solidarité ou de charité ? Cette prise en charge est-elle systématique ou bien certains individus y échappent-ils, leur dépouille connaissant in fine un traitement non funéraire ? » (page 9).
Au hasard des contributions, on glane des informations diverses comme l’importance de la mortalité infantile entre août et octobre sous l’Ancien Régime, le rôle des confréries pour prendre en charge l’enterrement des indigents (ceci ne concerne évidemment que les villes), que ce sont les ordres mendiants qui introduisent comme septième œuvre de miséricorde la tâche de contribuer financièrement à l’ensevelissement des morts, que le corps des condamnés à mort connaît divers destins avant d’être enterrés (dont certaines formes d’exposition et la dissection anatomique) au XVIIIe siècle, que l’épidémie de choléra en Angleterre entraîne la mise en place d’une nouvelle législation concernant les cimetières, que des enclos musulmans apparaissent dans les cimetières de la région parisienne (ceci en contradiction avec la loi de 1881 brogeant les enclos confessionnels), que le pape Clément X avait établi des indulgences pour les personnes au corps disséqué à la fin du XVIIe siècle (ce qui consolide l’évolution de l’Église sur les dissections), que l’enterrement à Anvers d’un socialiste-révolutionnaire en exil suscite des enjeux, que la mort de Marocains en Espagne amène à poser la question d’un rapatriement de leur corps à partir d’une certaine date (par ailleurs sur netflix la série La Bonne Terre évoque l’idée d’un jeune entrepreneur d’importer de la terre du Maroc pour inhumer les morts de sa communauté), que des associations visant au rapatriement des corps de Marocains existent à côté de la création récente de carrés musulmans dans certains cimetières espagnols et que l’ouverture à la concurrence des pompes funèbres en 1993 (sur ordre de directives européennes) a entraîné une inflation considérable des coûts d’inhumation et qu’une prise en charge partielle ou totale des frais d’inhumation a été mis en place par certaines communes pour les plus pauvres, enfin qu’un accompagnement de personnes SDF au cimetière est parfois réalisée par des membres d’association se donnant cet objectif.
Des allusions littéraires apparaissent comme un extrait conséquent du poème "Le cimetière du père Lachaise" par le chevalier Armand Philpin publié en 1827 (page 41) ou un passage de l’ouvrage Les Étrangers de l’écrivain hongrois antifasciste Sándor Márai (page 133). Il y a donc divers enjeux, notamment religieux et politiques, autour de pratiques de sacralisation ou de dégradation des dépouilles mortelles. Les aspects économiques occupent largement cette question d’inhumation et le statut social joue un rôle important dans le devenir des corps au décès des personnes.
Pour connaisseurs Peu d'illustrations